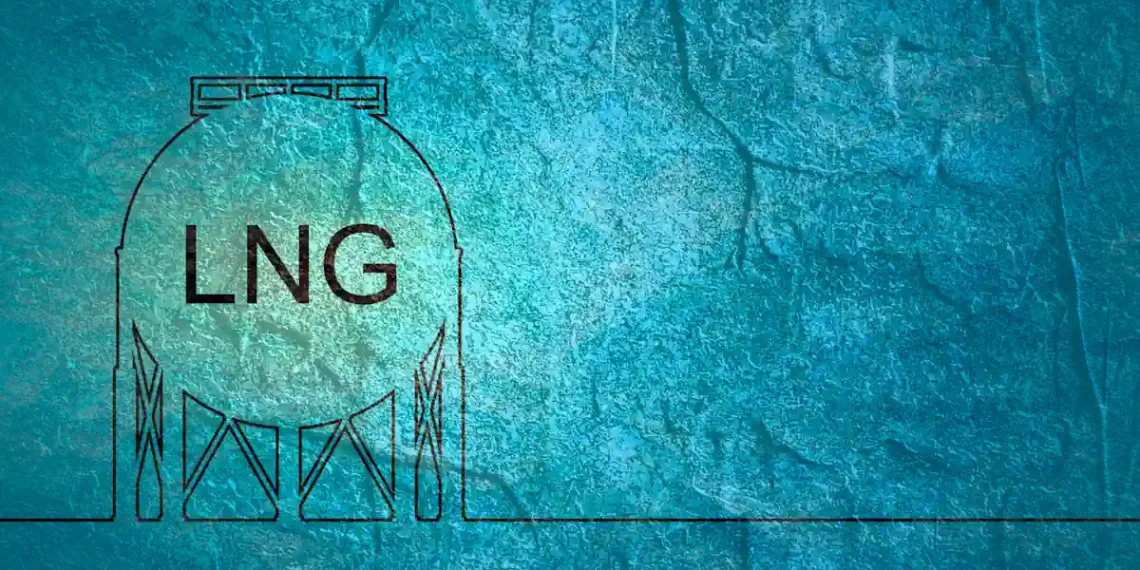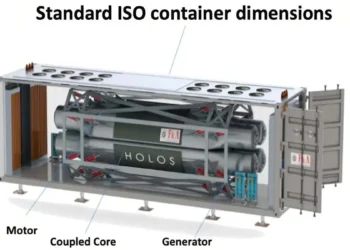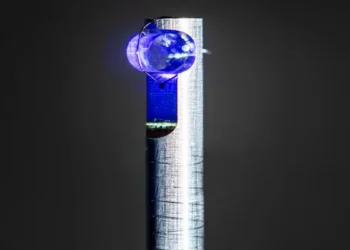Sarah M. Munoz, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) pourrait voir le jour à Baie-Comeau. Porté par l’entreprise Marinvest Energy, le projet se dit « carboneutre » grâce à un parc éolien. Mais peut-on vraiment verdir l’exportation d’énergies fossiles sans détourner le sens de la transition climatique ?
Selon une enquête du Devoir, la compagnie Marinvest Energy envisage de construire sur la Côte-Nord, en milieu marin, une usine de liquéfaction pour transformer le gaz naturel transporté d’Alberta et destiné à l’exportation. Son argument central ? Le projet serait « carboneutre » grâce à l’ajout d’un parc éolien privé qui alimenterait l’usine en énergie.
Si les détails du projet ne sont pas encore précisés par l’entreprise, Marinvest Energy annonce tout de même la volonté de produire du GNL « sans émission de carbone », afin de réduire l’empreinte du projet industriel. Mais cette rhétorique cache un problème de fond : peut-on réellement parler de carboneutralité dans le cadre de projets d’exportation d’énergies fossiles ?
Chercheuse postdoctorale à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM, j’étudie l’influence discursive et politique de l’industrie fossile et ce type de stratégie rhétorique. Elle consiste à déplacer la conversation vers des solutions technologiques partielles, à favoriser l’acceptabilité sociale d’infrastructures dangereuses, et à donner l’impression d’agir tout en verrouillant nos choix énergétiques.
Une neutralité carbone illusoire
Le projet de Marinvest Energy rappelle celui d’Énergie Saguenay, aussi de GNL Québec, rejeté en 2021 par le gouvernement Legault en raison de ses impacts environnementaux. Ce projet promettait aussi une neutralité carbone, cette fois par l’électrification partielle de ses équipements. La neutralité carbone consiste à réduire à un minimum, à compenser, ou à capturer les émissions de gaz à effet de serre (GES) de manière à en équilibrer la quantité émise avec la quantité retirée de l’atmosphère.
Depuis quelques années, les promoteurs de projets gaziers tentent de faire passer leurs projets pour compatibles avec la lutte climatique. Le discours s’ajuste : on insiste sur les « réductions d’émissions » locales, tout en gardant intact le modèle d’extraction et d’exportation.
Mais ce vocabulaire n’est pas anodin : il sert à verdir l’image d’un combustible fossile et à en accroître l’acceptabilité sociale. Cela s’apparente à de l’écoblanchiment (greenwashing) qui consiste à donner un caractère écoresponsable à des activités industrielles polluantes. Largement employée par les acteurs pétroliers et gaziers, cette rhétorique vise à créer, dans l’imaginaire collectif social et politique, l’illusion d’une compatibilité entre la production continue des énergies fossiles et la lutte contre les changements climatiques.
Or, le GNL reste une source majeure d’émissions de CO2. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 70 % des émissions associées au GNL proviennent de sa combustion finale, c’est-à-dire à l’étranger, là où il sera utilisé. Autrement dit, même si la production locale est « verte », l’impact climatique principal se produit ailleurs. C’est là tout le paradoxe du discours de carboneutralité : il fragmente les émissions pour mieux en dissimuler l’ampleur.
Un enjeu d’acceptabilité sociale
Ce type de discours vise aussi à accroître l’acceptabilité sociale du projet. Des études sur les publics canadiens, comme celle de Todd Brunner et John Axsen de l’Université Simon Fraser, ont montré que l’acceptabilité des infrastructures et des diverses énergies fossiles dépend des valeurs environnementales et de la confiance du public envers les compagnies pétrolières et gazières.
En associant le projet à l’énergie éolienne, Marinvest cherche ainsi à l’aligner symboliquement avec les politiques climatiques québécoises et à séduire une population déjà sceptique, comme celle qui s’était opposée à GNL Québec.
Le risque de verrouillage énergétique
Au-delà des enjeux des émissions, les mégaprojets de GNL posent un risque systémique : ils renforcent la dépendance canadienne et québécoise aux énergies fossiles. Le « verrouillage carbone » (carbon lock-in) est un phénomène bien documenté. Il désigne les choix économiques, technologiques ou politiques qui rendent difficile (et coûteux) l’abandon du pétrole et du gaz. Une fois le mégaprojet lancé, les investissements doivent être rentabilisés, et les infrastructures s’imposent pour des décennies.
L’Institut climatique du Canada rappelle l’importance d’adopter des politiques publiques pour prévenir cette dépendance, mais en souligne la complexité. Certains chercheurs parlent ainsi de « complexe techno-institutionnel » : un enchevêtrement d’intérêts publics et privés qui freine toute transition réelle. Ce complexe entraîne une dépendance durable aux technologies et aux structures institutionnelles liées aux énergies fossiles.
Au Québec, les projets comme GNL Québec, et maintenant celui de Marinvest Energy, ont d’ailleurs été critiqués non seulement pour leur impact local, mais aussi pour leur capacité à vérrouiller la trajectoire énergétique des pays importateurs – et ainsi à prolonger les émissions mondiales.
Pourtant, comme l’explique l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) dans un récent rapport, la neutralité carbone ne fonctionne qu’à l’échelle planétaire. Aucune entreprise ou territoire ne peut donc se dire « carboneutre » en elle-même. La neutralité implique une transformation en profondeur de nos modes de vie, et non l’ajout d’un parc éolien à un projet fossile.
Une transition détournée
« Décarboner » la production d’énergies fossiles sert donc à maintenir un modèle extractiviste en présentant la carboneutralité comme une forme d’engagement climatique. Mais ces récits ne sont pas neutres : ils sont politiques et participent à la continuité des intérêts fossiles. Ils évitent les débats sur les causes réelles du problème, comme notre dépendance structurelle aux hydrocarbures ou l’insuffisance des politiques climatiques actuelles.
Continuer à développer des infrastructures GNL, même en prétendant qu’elles sont carboneutres, contribue ainsi à entretenir ce verrouillage industriel et freine la sortie nécessaire des énergies fossiles.
Or, comme l’a récemment rappelé le secrétaire général des Nations unies António Guterres, l’ère des énergies fossiles responsables du « chaos climatique » doit toucher à sa fin. Face à l’urgence climatique, ce dont nous avons besoin n’est pas de verdir le gaz, mais de le laisser sous terre.
Sarah M. Munoz, Chercheuse postdoctorale – Postdoctoral fellow, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.