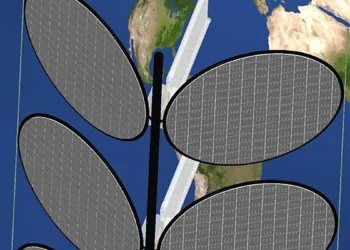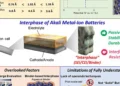Roberto Uchôa de Oliveira Santos, Universidade de Coimbra
La guerre mondiale contre la drogue est entrée dans une nouvelle phase inquiétante. En juillet 2025, la saisie du premier narco-sous-marin sans pilote et téléguidé par la marine colombienne a signifié plus qu’une opération réussie contre le trafic de drogue. Elle représente également la matérialisation d’un changement de paradigme technologique et stratégique. Ce qui avait commencé il y a plusieurs décennies comme une tactique logistique de contre-insurrection des cartels colombiens s’est transformé en une menace sophistiquée qui cible désormais directement le trafic transocéanique, avec une efficacité sans précédent.
L’évolution d’une menace submergée
Le concept de narco-sous-marin est né d’une nécessité. À la fin du XXe siècle, le intensification de la surveillance dans les ports et les aéroports a contraint les cartels colombiens à chercher un nouvel espace pour transporter la cocaïne : le milieu sous-marin. Les premiers bateaux, construits dans des chantiers navals clandestins au cœur de la jungle, étaient rudimentaires. Au fil du temps, ils ont évolué pour devenir des semi-submersibles autopropulsés (SPSS), conçus pour naviguer avec un profil minimal au-dessus de l’eau, ce qui les rend presque invisibles à l’œil nu et difficiles à détecter par radar.
L’opération « Marée noire » de novembre 2019, qui a abouti à la première saisie d’un narco-sous-marin en Europe, a donné un aperçu des conditions inhumaines qui régnaient à bord. Un équipage de trois personnes a parcouru près de 6 500 kilomètres entre le Brésil et l’Espagne à bord d’une embarcation de 22 mètres, le « Che ». Pendant près d’un mois, ils ont affronté des tempêtes, des conditions sanitaires inexistantes et un environnement claustrophobe, motivés par une cargaison de trois tonnes de cocaïne d’une valeur de plusieurs centaines de millions d’euros. Cette affaire illustre le modèle commercial à haut risque des organisations criminelles, où les équipages sont traités comme des actifs jetables.
Le pivot transatlantique : l’Europe comme destination principale
Alors que les routes du Pacifique vers les États-Unis restent actives, la dernière décennie a été témoin d’un pivot stratégique monumental vers le marché européen. Poussées par des prix plus élevés et des marges bénéficiaires plus importantes, les organisations criminelles ont établi un solide pont transatlantique. Les saisies de cocaïne en Europe dépassent désormais celles des États-Unis, ce qui confirme le changement d’orientation.
Dans cette nouvelle géographie, le Brésil est devenu un « pivot » logistique essentiel. Son vaste littoral atlantique et la présence du premier commandement de la capitale (PCC) ont créé la plateforme de lancement idéale. Le trafic de drogue moderne fonctionne désormais dans un écosystème décentralisé, semblable à une franchise mondiale. Les cartels colombiens jouent le rôle de « producteurs », tandis que le PCC s’est imposé comme le principal « franchisé » logistique pour l’Atlantique, avec une présence établie en Afrique et en Europe pour faciliter la distribution.
La péninsule ibérique est la principale porte d’entrée. La côte accidentée de la Galice, en Espagne, est devenue une destination idéale. Après l’interception du « Che » en 2019, un deuxième sous-marin, le « Poseidon », a été découvert en mars 2023. Bien que vide, la découverte de vedettes rapides (« narcolanchas ») à proximité suggère que sa cargaison a été transférée avec succès au large avant que le navire ne soit coulé, démontrant une méthode opérationnelle raffinée.
Le Portugal s’est consolidé en tant qu’autre point d’entrée crucial. En mars 2025, l’opération « Nautilus » a intercepté un semi-submersible à 900 kilomètres des Açores avec une cargaison massive de 6,6 tonnes de cocaïne. L’interception, réalisée en plein océan, a été un succès remarquable, empêchant l’équipage multinational, composé de Brésiliens, d’un Colombien et d’un Espagnol, de couler le navire. L’itinéraire, de l’embouchure de l’Amazone au Brésil jusqu’au Portugal, souligne la nature et l’ampleur de ces opérations transnationales.
Le changement de paradigme : l’ère du « sous-marin fantôme » sans pilote
La saisie du premier « drone submersible » du trafic de drogue en juillet 2025, dans les Caraïbes colombiennes, représente une percée technologique. Le navire, attribué au Clan du Golfe, a été retrouvé vide, probablement en « phase de test ». Cette découverte a confirmé les craintes des services de renseignement, qui surveillaient depuis des années les efforts des organisations criminelles transnationales pour développer des sous-marins sans pilote.
La sophistication du prototype réside dans sa technologie. Équipé d’une antenne Internet par satellite Starlink, il pourrait être piloté à distance depuis n’importe quel endroit du monde, ce qui représente un bond en avant par rapport aux systèmes de communication précédents. Sa conception hydrodynamique et discrète le rend extrêmement furtif et presque insensible à la détection radar.
La transition vers des systèmes sans pilote modifie radicalement l’analyse des risques et des bénéfices pour les organisations criminelles. Le principal avantage est l’élimination du risque humain. En cas de capture, la perte est purement matérielle ; il n’y a pas d’équipage à arrêter et à interroger. </Le maillon le plus faible de la chaîne opérationnelle est supprimé, ce qui crée d’énormes obstacles procéduraux et rend l’attribution de la responsabilité pénale presque impossible. Libérés des contraintes biologiques, ces UUV (Unmanned Underwater Vehicles) peuvent effectuer des missions plus longues et plus risquées, ce qui rend le modèle commercial mondial plus efficace et plus résistant.
Le champ de bataille asymétrique et l’avenir de la narco-guerre
La lutte contre les narco-sous-marins est un exemple classique de guerre asymétrique. Leur construction en fibre de verre et leur profil bas les rendent « presque invisibles » pour les radars et les sonars. Les garde-côtes américains estiment que seul un sur quatre est intercepté, ce qui permet à un volume considérable de drogue d’atteindre sa destination.
Compte tenu de la difficulté de détection, la stratégie la plus viable est une approche axée sur le renseignement pour démanteler les réseaux terrestres, grâce à la coopération internationale, au contrôle des précurseurs et à la traçabilité financière. Cependant, la menace continue d’évoluer. Les trajectoires futures laissent entrevoir l’utilisation d’essaims d’UUV pour saturer les défenses, une navigation autonome alimentée par l’IA pour éviter les patrouilles, et des navires submersibles entièrement électriques qui seraient pratiquement indétectables.
Le narco-sous-marin est passé d’un outil tactique improvisé à une arme stratégique de premier ordre dans l’arsenal de la criminalité organisée transnationale. L’arrivée des systèmes sans pilote marque le début d’une nouvelle ère de la narco-guerre, où la technologie, la furtivité et le déni plausible donnent aux organisations criminelles transnationales un avantage asymétrique écrasant. </La réponse des États ne peut être réactive. Il est urgent de passer d’une stratégie d’interdiction physique à une stratégie de perturbation des réseaux, fondée sur le renseignement, la maîtrise technologique et l’innovation juridique. Si l’on ne s’adapte pas à cette nouvelle réalité submergée, les organisations criminelles continueront à naviguer, invisibles et impunies, sous les vagues de la sécurité mondiale.
Roberto Uchôa de Oliveira Santos, Pesquisador e doutorando, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra
Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.