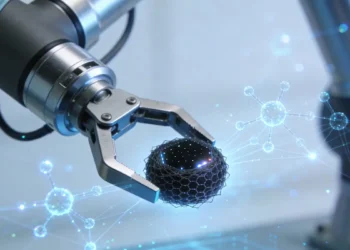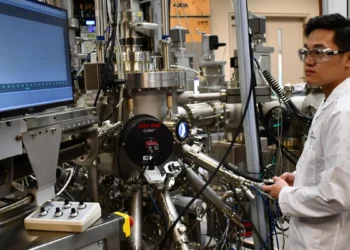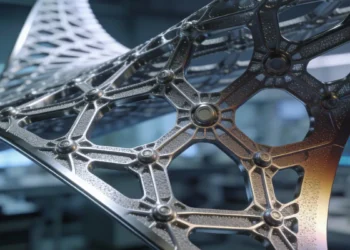Une petite boîte blanche se déplace lentement sur l’herbe du parc situé entre la gare centrale de Berlin et la chancellerie allemande. Avec son voyant orange clignotant et le bruit d’aspiration qu’elle émet, elle attire beaucoup l’attention. Cet assistant inhabituel est un robot aspirateur de la BSR (Berlin Waste Management) qui nettoie les mégots de cigarettes, les capsules de bouteilles et autres petits déchets. Développé par Angsa Robotics, il est surveillé par des chercheurs de l’Université technique de Berlin et d’autres partenaires du projet de recherche ROKIT (Robots in Public Spaces : Competence Cluster for Interdisciplinary Technology Design). Leur objectif : explorer comment les robots mobiles peuvent être utilisés de manière significative, sûre et inclusive dans les espaces publics.
La phase de test dans le Spreebogenpark fait partie d’une étude de terrain approfondie ; il s’agit du troisième test sur le terrain dans le cadre du projet. La philosophe de la technologie Lena Fiedler utilise une tablette pour enregistrer les réactions des passants face au robot : intéressés, curieux, parfois en train de le filmer.
« Personne n’en a eu peur », dit-elle. « Notre tâche dans le cadre du projet consiste à mettre en évidence les défis éthiques et à développer des solutions, par exemple lorsque la faisabilité technique se heurte à des préoccupations éthiques. Le bruit d’aspiration est très fort et peut déranger les animaux et les personnes, et aspirer les insectes. Un bras robotisé serait moins invasif, mais présenterait davantage de vulnérabilités techniques. »
Il s’agit là d’un exemple typique de la manière dont la valeur ajoutée est mise en balance avec d’autres facteurs à la chaire de dynamique des connaissances et de technologie durable de l’université technique de Berlin : qu’est-ce qui est possible ? Qu’est-ce qui est important pour nous ?
Les approches de recherche participative, telles que celles utilisées par Sophie Schwartz, sont essentielles pour répondre à ces questions. Sophie Schwartz, étudiante en facteurs humains à l’université technique de Berlin, rédige son mémoire de master sur ROKIT. Elle a invité des personnes aveugles et malvoyantes à interagir avec le robot, puis a organisé une discussion de groupe.
« Nous devons reconnaître que les personnes handicapées sont les expertes de leurs propres besoins et nous devons les impliquer dès le début dans la recherche en tant que co-créatrices », explique-t-elle. Cette perspective est cruciale pour concevoir des robots aussi inclusifs que possible pour les divers groupes qui utilisent les espaces publics.
Des espaces publics inclusifs pour tous ?
Le projet ROKIT rassemble des chercheurs en éthique, technologie, droit et conception. Leur objectif est de rédiger des propositions pour la conception de robots mobiles afin qu’ils soient fonctionnels tout en se comportant de manière socialement acceptable et respectueuse dans les espaces publics. L’équipe de l’université technique explore également les questions suivantes : qu’est-ce qu’un espace public juste ? Quelles règles de conduite les robots doivent-ils suivre en public ? Une conclusion clé : les normes sociales ne sont pas toujours moralement correctes, les robots ne doivent donc pas simplement imiter le comportement humain.
« Les robots ne doivent pas adopter les normes socialement injustes des espaces publics. Si les femmes sont plus susceptibles que les hommes de s’écarter du chemin de quelqu’un, alors un robot ne doit pas reproduire ce comportement », ajoute le professeur Sabine Ammon, responsable du projet au Berlin Ethics Lab de l’université technique de Berlin. « Les espaces publics sont des lieux de rencontre et un bien commun.
La diversité, l’inclusion et l’équité sont des valeurs qui doivent être préservées, pour les personnes, les animaux et la nature. » Le projet offre donc des orientations importantes pour la conception éthique des technologies.

Quel type de technologie est réellement développé ici ?
Une attention particulière est accordée à l’intégration de la réflexion éthique dans le processus de conception. L’équipe du professeur Ammon développe une nouvelle procédure appelée « consultation éthique ». Elle permet des interventions éthiques ciblées à différentes étapes du développement, sans que les éthiciens aient à être impliqués en permanence dans le processus technique.
« Nous devons de toute urgence intégrer des méthodes de conception éthiques dans le processus de recherche et de développement afin de faciliter une réflexion précoce : quel type de technologie est réellement développé ici ? Quelles sont ses conséquences sociales ? », commente Sabine Ammon, qui dirige la chaire interdisciplinaire « Knowledge Dynamics and Sustainable Technology » (Dynamique des connaissances et technologie durable).
Promouvoir la réflexion éthique à long terme
Les connaissances acquises dans le cadre du projet sont également transmises à d’autres étudiants afin qu’ils puissent intégrer ces nouvelles connaissances dans leurs travaux futurs. L’un des outils clés à cet effet est le certificat d’éthique de Berlin, que tous les étudiants peuvent obtenir dans le cadre de leurs études. Il les aide à acquérir des compétences importantes pour la réflexion éthique. Ils ont ainsi la possibilité de se pencher très tôt et de manière pratique sur les questions éthiques liées à l’IA et à la robotique.
Source : UT Berlin