L’hypothèse selon laquelle, il y a 635 millions d’années, la Terre aurait été entièrement recouverte de glace, vient de prendre un coup de chaud.
La concentration atmosphérique en CO2 durant cette période est beaucoup plus faible que prévu, c’est ce que révèle une équipe de chercheurs français de l’Institut de physique du globe de Paris (CNRS/IPGP/Université Paris Diderot), en collaboration avec le laboratoire Géologie et gestion des ressources minérales et énergétiques(1) ainsi qu’avec des scientifiques brésiliens et américains. Leur étude, parue dans la revue Nature du 6 octobre 2011, remet en cause une partie de cette hypothèse dite de la Terre « Boule de Neige » et relance le débat sur l’origine du mécanisme de déglaciation.
La Terre a traversé plusieurs épisodes glaciaires extrêmes, dont deux durant la période géologique bien nommée du Cryogénien (il y a 710-630 millions d’années). En 1992 et en 1998, des scientifiques ont émis l’hypothèse qu’il y a environ 635 millions d’années, notre planète aurait connu un épisode glaciaire majeur, laissant le globe entièrement recouvert de glace. Encore aujourd’hui, la question de la sortie d’un tel épisode reste en suspens, sachant que la glace renvoie une plus grande partie du rayonnement solaire que les roches. Dans cette hypothèse de la Terre « Boule de Neige », on supposait que du CO2 d’origine volcanique s’était accumulé dans l’atmosphère en quantité suffisante pour que ce gaz à effet de serre ait pu réchauffer la surface de la planète et provoquer la fonte des glaces. Théoriquement, les teneurs en CO2 proposées dans le cadre de cette hypothèse devaient varier autour de 120 000 ppmv(2) (soit 12%), un taux 300 fois supérieur aux teneurs actuelles.
Afin d’estimer la teneur en CO2 atmosphérique pour cette période, les chercheurs français, brésiliens et américains ont étudié des carbonates déposés il y a 635 millions d’années (glaciation Marinoenne). Ces premiers sédiments recouvrent les dépôts glaciaires de cette période, considérée comme le témoin d’une glaciation globale, la fameuse Terre « Boule de Neige ». Cette étude se base sur la différence des compositions isotopiques du carbone entre les carbonates et la matière organique d’organismes fossilisés, reliée à la teneur en CO2 atmosphérique. Les résultats montrent une concentration très proche de l’actuelle (et inférieure à 3 200 ppmv), soit une teneur très insuffisante pour sortir d’un épisode glaciaire d’une telle importance.
Cette étude non seulement remet en cause une partie de l’hypothèse Terre « Boule de Neige », mais elle implique également que ces épisodes glaciaires n’ont pas été aussi intenses que précédemment proposé.
En outre, ces mêmes données s’accordent avec l’idée qu’à la même période, l’atmosphère aurait été beaucoup plus pauvre en oxygène, autour de 1%, alors qu’aujourd’hui, elle est de l’ordre de 20%. Dès lors, les scientifiques doivent se pencher sur d’autres mécanismes de déglaciation ou bien sur d’autres gaz que le CO2, tel que le méthane, également avancé dans le cadre de cette hypothèse.

Légende : Affleurement de la carrière de Terconi, Mato Grosso, Brésil. La partie inférieure montre une couche dolomitique rose surmontée de calcaires gris, plus riche en matière organique. Ces carbonates reposent directement au-dessus des sédiments glaciaires Marinoens.
(1) Laboratoire Géologie et gestion des ressources minérales et énergétiques (CNRS/ Université de Nancy/INPL Nancy/ Centre de Recherches sur la Géologie des Matières Premières Minérales et Energétiques)
(2) ppmv : (partie par million en volume)
Références :
A carbon isotope challenge to the snowball Earth, P. Sansjofre, M. Ader, R. I. F. Trindade, M. Elie,
J. Lyons, P. Cartigny et A. C. R. Nogueira – Nature, 6 octobre 2011

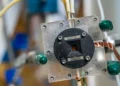








l’effet réel du CO2 sur « l’effet de serre » (la tarte à la crème des alarmistes du climat) va faire « pschitt », comme dirait un ex président bien aimé ?
La traduction française du titre est plus directe que l’original, « A carbon isotope challenge to the snowball Earth ». Le cœur de la discussion concerne les méthodes analytiques de détermination des paleo-concentrations de CO2. Lorsqu’ils ont proposé le modèle « Boule de Neige » dans les années 90, les chercheurs se sont appuyés sur les fortes concentrations de CO2 (50 à 225 fois plus qu’aujourd’hui) qu’ils déduisaient d’analyses isotopiques du Bore et de l’Oxygène pour compléter leur modèle d’un mécanisme de déglaciation crédible. Dans ce dernier article, les nouveaux auteurs concluent sur la base de données analytiques obtenues à partir d’analyses isotopiques du Carbone que la concentration en CO2 semble ne jamais avoir dépassé ~8 fois la concentration actuelle, et était sans doute à peine plus élevée qu’aujourd’hui. Ce qui invaliderait le mécanisme de déglaciation proposé dans les années 90. Conclusion de l’article récent: soit un autre mécanisme de déglaciation a agi, soit il n’y a pas eu de Terre « Boule de Neige » à cette époque. Il est sans doute utile de rappeler également que ces études qui concernent la fin du Précambrien n’ont aucun rapport avec les études de concentration de CO2 de l’atmosphère basées sur l’analyse de carottes glaciaires et qui elles permettent de remonter sur 800 000 ans environ.