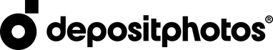Ses limites? Tout d’abord, les scénarios ne se différencient de façon significative que dans trois décennies. Ensuite, les conséquences concrètes du changement climatique sont incertaines. Pour autant, on ne peut s’exonérer d’une réflexion sur les avenirs possibles. Cette réflexion, menée aujourd’hui par des pays et des collectivités locales, mais aussi de grandes entreprises (assurance, gestion d’infrastructures, production d’énergie) aide à identifier des risques et des contraintes. Elle permet aussi de pointer l’émergence de nouveaux services.
L’extraction, le transport et la combustion d’énergies fossiles ne produisent pas seulement du CO2, mais aussi d’autres gaz à effet de serre (fuites de méthane) ainsi que l’émission de particules, dont certaines ont un effet refroidissant (sulfates) ou réchauffant (suies). La combustion de biomasse agit également sur l’évolution du climat à travers les effets liés à la combustion (gaz à effet de serre et particules) et ceux liés à la déforestation lorsqu’il s’agit de l’exploitation de forêts non renouvelées. C’est l’ensemble de ces facteurs que l’on doit prendre en compte si l’on veut comparer les impacts climatiques des différentes filières énergétiques.
Une machine complexe : la Terre
Notre planète peut être vue comme une machine thermique qui intercepte de l’énergie solaire et en transforme une partie en chaleur, en mouvement de l’air ou en précipitations. L’humanité est devenue au fil du temps un acteur majeur de cette transformation. Elle manipule aujourd’hui des quantités d’énergie qui en font un acteur important à l’échelle des équilibres planétaires.
Il ne s’agit pas seulement de l’essence que consomment nos voitures et nos usines, mais tout simplement de notre subsistance : notre nourriture est issue de la photosynthèse et les questions d’alimentation sont aussi des problèmes d’énergie. Nous contribuons également à modifier les équilibres énergétiques planétaires en consommant des énergies fossiles, pétrole, charbon ou gaz accumulés pendant des millions d’années et correspondant à un cumul d’énergie solaire transformée par la photosynthèse.
L’effet net de la combustion d’énergie fossile, de la déforestation et de la production de ciment correspond actuellement à un rejet annuel de CO2 vers l’atmosphère de 11 gigatonnes de carbone par an. Certes, chaque année, la moitié de ces émissions est absorbée par ces puits naturels que sont les océans, la végétation et les sols. Ceci entraîne également une acidification des océans. Mais l’autre moitié de ces émissions s’accumule aux émissions antérieures dans l’atmosphère, modifiant profondément sa composition. La concentration en dioxyde de carbone a ainsi augmenté de 40% depuis 1750 ; la concentration de méthane a augmenté de 150% au cours de la même période. Cela correspond à une rupture par rapport à la composition atmosphérique au cours des derniers 800 000 ans, connue grâce à la mémoire que constituent les bulles d’air piégées dans les glaces de l’Antarctique.
Ces changements de concentration de gaz à effet de serre ont un effet majeur sur le climat. La figure ci-dessous présente de manière schématique le fonctionnement de l’atmosphère. Celle-ci laisse passer la majeure partie du rayonnement solaire, qui chauffe la surface des continents et des océans. Les flux d’énergie depuis la surface des continents et des océans chauffent alors le bas de l’atmosphère, qui émet à son tour un rayonnement infra-rouge, dont une partie réchauffe les basses couches de l’atmosphère et la surface de la planète, et une partie sort vers l’espace.
Plus la concentration de gaz à effet de serre augmente dans l’atmosphère, plus celle-ci est efficace pour piéger le rayonnement infra-rouge, réduisant les émissions infra-rouges vers l’espace, ce qui entraîne un réchauffement de la surface planétaire et des basses couches de l’atmosphère. Une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre se traduit donc par une accumulation d’énergie dans le système climatique, ce qui se traduit par des changements de température des océans, de l’air en surface, et des changements du cycle de l’eau, de certains événements extrêmes (vagues de chaleur, fortes précipitations), une fonte des glaces, et une augmentation du niveau des mers.
C’est ainsi que notre consommation énergétique participe au phénomène de réchauffement climatique planétaire mesuré par les données météorologiques et océanographiques, et que l’on appelle également «changement climatique » pour souligner le fait qu’il ne s’agit pas seulement d’un réchauffement mais aussi de modifications d’autres aspects (cycle de l’eau, circulation atmosphérique, acidification des océans, niveau des mers, évènements extrêmes). Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas la chaleur dégagée par la combustion d’énergie qui modifie le climat (cet effet est palpable à l’échelle très locale, par exemple dans une agglomération en hiver, mais négligeable au niveau planétaire), mais l’effet de serre lié aux gaz rejetés dans l’atmosphère.
Au cours du temps, le climat de la Terre a subi des fluctuations importantes, en réponse à des modifications de la composition de l’atmosphère, à l’échelle géologique, à des changements de l’activité du Soleil ou l’orbite de la Terre autour de son étoile, ou enfin du fait d’éruptions volcaniques majeures. À contexte géologique ou orbital identique, il est possible de comparer les changements en cours par rapport aux variations naturelles du climat au cours des siècles ou millénaires précédant la période industrielle. Les enregistrements paléoclimatiques révèlent que le réchauffement des derniers 30 ou 50 ans, la montée du niveau des mers, ainsi que le retrait de la banquise arctique sont exceptionnels dans le contexte des derniers 1400 ans.
La réponse du climat à des perturbations du bilan radiatif terrestre met en œuvre des mécanismes complexes de rétroactions. Les principales rétroactions qui amplifient le réchauffement de l’atmosphère tiennent au fait qu’une atmosphère plus chaude va pouvoir contenir davantage de vapeur d’eau (qui ajoute de l’effet de serre), à des modifications de la répartition des nuages (avec un effet dominant de réchauffement supplémentaire), aux effets de réchauffement lié à la fonte de la neige ou de la banquise (remplacés par des surfaces plus sombres, qui vont davantage absorber le rayonnement solaire). Le terme modérateur provient du stockage de chaleur en profondeur dans les océans, ce qui représente aujourd’hui 93% de l’énergie supplémentaire dans la machine climatique. Ce réchauffement des océans agit ensuite sur l’atmosphère, ainsi que sur le niveau des mers, avec des conséquences sur le long terme (à l’échelle de plusieurs siècles). Enfin, un climat qui change devrait entraîner également des modifications de la capacité des océans et des surfaces continentales à piéger une fraction importante des émissions de dioxyde de carbone dues aux activités humaines : à quantité d’émissions identiques, le changement climatique sera plus important si les puits de carbone sont moins efficaces, ou si le dégel des zones arctiques relâche des quantités importantes de gaz à effet de serre vers l’atmosphère.
L’évolution du climat se joue ainsi dans ces rétroactions multiples, que les scientifiques travaillent à modéliser, à partir de la compréhension des lois physiques, et la représentation simplifiée des processus de petite échelle comme la formation des nuages. Il me semble utile, à ce stade, de lever une équivoque : l’évaluation des risques climatiques futurs ne repose absolument pas sur une extrapolation à partir de séries passées. Les modèles numériques de climat sont construits à partir des modèles de circulation atmosphérique utilisés pour la prévision météorologique, mais en intégrant les différentes composantes de la machine climatique (océan, atmosphère, y compris le cycle de l’eau, mais aussi chimie atmosphérique, cycle du carbone, banquise, interactions végétation atmosphère…). Ces modèles de climat sont en permanence testés sur leur capacité à représenter les mécanismes de fonctionnement du climat, les rétroactions, les changements passés à différentes échelles de temps, par confrontation à tout un ensemble d’informations (données paléoclimatiques, mais aussi mesures météorologiques, océanographiques, mesures spatiales etc.). Les incertitudes associées à ces modèles numériques peuvent être abordées vis à vis de l’état initial du climat (par exemple, l’état initial de l’océan), ou en faisant varier certains paramètres mal contraints des modèles, ou bien en comparant systématiquement les 40 modèles de climat qui sont développés dans différents laboratoires de recherche mondiaux. Chaque modèle de climat produit une variabilité dite « interne », liée aux interactions entre la circulation de l’océan et de l’atmosphère, ainsi qu’une réponse aux perturbations du bilan radiatif terrestre, qu’elles soient d’origine naturelle (activité du soleil et des volcans) ou liées aux activités humaines. La confrontation de simulations prenant en compte ces différents facteurs et observations est essentielle pour estimer la ou les causes de changements observés.
Les sciences du climat sont un domaine de recherche académique très vivant, avec des progrès majeurs dans les observations au sol, en mer ou par télédétection (et même l’étude des climats passés), dans la compréhension des processus en jeu, et dans la modélisation numérique du climat actuel, de climats passés, ou de scénarios d’évolution future du climat, en réponse à différents scénarios d’évolution de la composition atmosphérique, en relation avec les activités humaines.
À partir des milliers de publications scientifiques chaque année, il est très difficile pour un scientifique donné d’avoir une vision d’ensemble de l’état des connaissances. Compte tenu des enjeux, pour les différents pays, liés au changement climatique, une structure unique a été mise en place en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Le GIEC a pour mandat de produire régulièrement des rapports d’évaluation sur l’état des connaissances concernant le changement climatique. Ces rapports sont rédigés par des centaines de scientifiques, à partir des publications relues par les pairs. Plusieurs étapes de relecture par la communauté scientifique contribuent à la qualité de la synthèse critique qui est effectuée.
En septembre dernier, le 5e rapport du groupe 1 du GIEC, qui porte sur l’état des connaissances sur le fonctionnement du système climatique, a été rendu public. Il fait suite à quatre rapports publiés en 1991, 1995, 2001 et 2007. Les conclusions de chaque rapport évoluent selon l’état des connaissances, et les rapports détaillés incluent une analyse des points robustes, des principales incertitudes, et des controverses scientifiques. L’une des spécificités de ces rapports tient à une formulation très précise du degré de confiance associé à chaque conclusion, prenant en compte une évaluation qualitative et, si possible, quantitative (probabiliste) des éléments disponibles.
Ces précautions prises, entrons dans le vif du sujet, en examinant de plus près certains des mécanismes à l’œuvre (voir ici).
Valérie Masson-Delmotte
Paléoclimatologue, directrice de recherche, CEA
[ Archive ] – Cet article a été écrit par Paristech