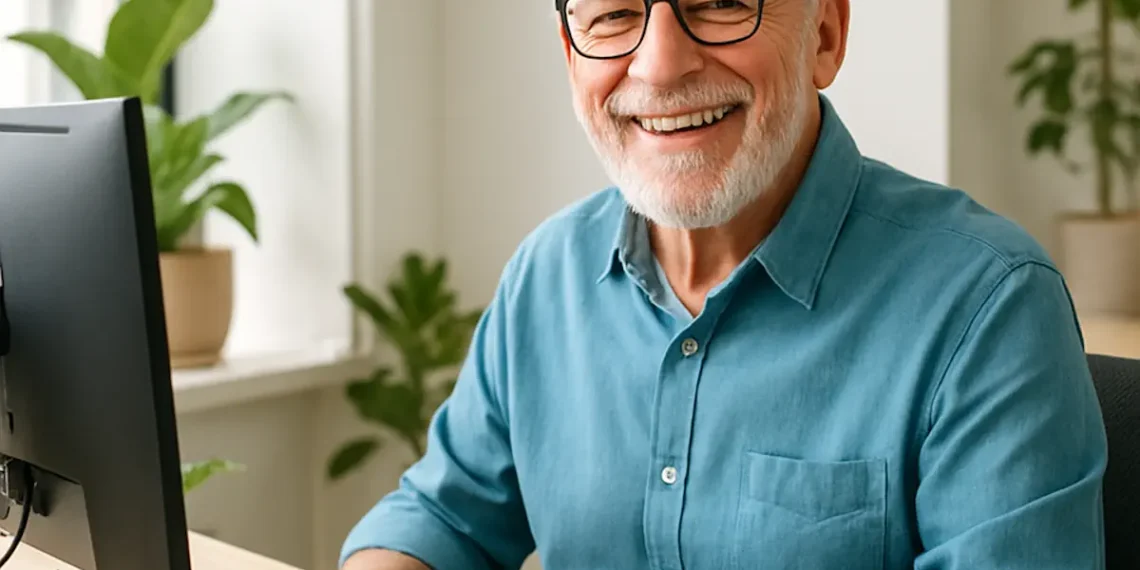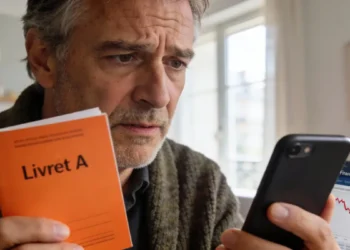À compter du 1ᵉʳ septembre 2025, il sera possible de lever le pied au travail dès 60 ans tout en touchant une partie de sa pension, grâce à l’élargissement du dispositif de retraite progressive. Abaissement de l’âge d’accès, inclusion des fonctionnaires et des indépendants : la réforme portée par deux décrets publiés le 23 juillet 2025 rebat les cartes d’une fin de carrière longtemps jugée rigide. Reste à comprendre les conditions, les avantages mais aussi les limites d’une mesure saluée par les partenaires sociaux pour son potentiel à maintenir les seniors en emploi, tout en leur offrant une transition plus douce vers la retraite définitive. Tour d’horizon.
Un dispositif assoupli : travailler moins tout en cotisant
La retraite progressive autorise un passage en douceur vers la cessation d’activité : le salarié réduit son temps de travail entre 40% et 80% d’un temps complet et perçoit simultanément une fraction de sa pension correspondant à la différence entre 100% et son taux d’activité (un temps partiel de 60% ouvre donc droit à 40% de la pension provisoire). Pendant cette période, les cotisations retraite continuent de courir ; il est même possible de sur-cotiser sur la base d’un salaire à temps complet afin d’accroître ses droits futurs. Lors du départ définitif, la pension est recalculée et ne peut être inférieure au montant provisoire initial.
Des conditions d’éligibilité resserrées mais accessibles
Le critère majeur qui change au 1ᵉʳ septembre 2025 est l’âge plancher, désormais fixé à 60 ans.
Deux autres conditions demeurent :
- 150 trimestres d’assurance (tous régimes de base confondus) ;
- Exercer une activité salariée ou non salariée à temps partiel ou réduit dans la fourchette 40–80%.
Certaines professions – par exemple l’administrateur d’un groupement mutualiste ou l’artisan vendant des biens qu’il confectionne – restent exclues du dispositif.
Vous pouvez désormais connaître les conditions de départ en retraite progressive avec ce simulateur
Démarches : un guichet unique et des pièces incontournables
La demande s’effectue en ligne via le service « Demander ma retraite progressive » du portail Info Retraite, au plus tôt cinq mois avant la date souhaitée. Une attestation employeur confirmant le taux de temps partiel doit impérativement être jointe. Les salariés sans accès à Internet peuvent recourir au formulaire papier adressé à leur(s) caisse(s) de retraite. Un récépissé atteste alors la prise en compte du dossier, lequel reste valable pour l’ensemble des régimes concernés.
Versement, suivi et simulation des droits
Durant la retraite progressive, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) calcule une pension provisoire et communique aux autres régimes la quotité versée. En cas de modification du temps de travail, le taux de pension est ajusté. Les assurés peuvent estimer leur future pension à tout moment via l’outil « Mon estimation retraite ».
Lors du passage en retraite complète, la pension définitive est recalculée en intégrant la période de travail à temps partiel, sans pouvoir descendre sous le montant provisoire initial.
Les enjeux et les perspectives
L’abaissement de l’âge d’accès à 60 ans intervient dans un contexte de vieillissement de la population active et de recherche d’équilibre financier pour les régimes. Pour l’assuré, la formule offre une flexibilité bienvenue, notamment dans les métiers pénibles ou exigeants. Pour les entreprises, elle peut servir d’outil de gestion des fins de carrière et de transmission des compétences. Reste la question de la lisibilité : faute d’accompagnement, certains salariés risquent de passer à côté de ce droit. À moyen terme, la montée en puissance du dispositif pourrait peser sur les comptes des régimes complémentaires, appelés à verser des fractions de pensions plus précocement.
Avec l’ouverture de la retraite progressive dès 60 ans, le législateur fait le pari d’un « atterrissage en douceur » sur le marché du travail, qui concilie le mieux-être des seniors et la soutenabilité du système.
Source : Service-public.fr