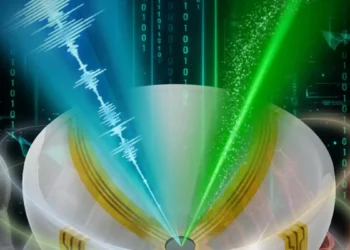Les pneumatiques qui équipent nos véhicules dissimulent un cocktail de près de 2 000 molécules, dont 40% présentent des risques graves pour la santé humaine et les écosystèmes. Telles sont les conclusions alarmantes d’une enquête menée par l’association Agir pour l’environnement, publiée début novembre 2025, qui lève le voile sur la composition toxique des gommes des principales marques européennes. Chaque année en France, l’abrasion des pneus libère environ 50 000 tonnes de substances dans l’air, les sols et les eaux, exposant la population à des pathologies lourdes. Face à un danger invisible, l’association appelle à une révision urgente de la réglementation européenne.
Un inventaire chimique préoccupant
Pour établir son diagnostic, Agir pour l’environnement a confié au laboratoire britannique indépendant Emissions Analytics l’analyse de six modèles de pneus « tout-temps » issus des marques Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin et Pirelli. Par pyrolyse ( chauffage à 600°C en l’absence d’oxygène ) les chercheurs ont pu identifier avec précision les composés organiques contenus dans la bande de roulement, partie en contact direct avec la chaussée.
Les résultats dépassent les prévisions les plus sombres. Au total, 1 954 molécules différentes ont été recensées à travers les six échantillons, chaque pneu contenant entre 718 et 893 substances distinctes. Parmi elles, 785 présentent des dangers avérés selon le règlement européen CLP relatif à la classification des produits chimiques. Autrement dit, quatre composés sur dix contenus dans la gomme de roulement représentent une menace directe.
La proportion de molécules toxiques varie selon leur famille chimique. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), connus pour leur cancérogénicité, constituent 40 à 60% des composés organiques identifiés. S’y ajoutent alcanes, alcènes et leurs dérivés cycliques (33 à 50%), responsables d’irritations des muqueuses et de dommages organiques. Enfin, acides et alcools, majoritairement néfastes pour l’environnement, complètent un tableau à hauteur de 10%.
Des menaces multiples sur la santé
L’analyse détaillée des codes de danger révèle un panorama clinique assez inquiétant. Parmi les 785 molécules à risque identifiées, 112 sont classées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). Le rapport, dont Magali Leroy a assuré les enquêtes et analyses, dénombre également 14 substances mortelles en cas d’ingestion, 10 mortelles par contact cutané et 19 mortelles par inhalation.
Les citoyennes et citoyens ont le droit de connaître la composition exacte des produits qu’ils achètent et avec lesquels ils s’empoisonnent, déclare Oliver Charles, coordinateur des campagnes climat, énergie et transports chez Agir pour l’environnement.
Les dangers les plus fréquents concernent l’irritation cutanée (330 molécules), la sévère irritation oculaire (303 molécules), la toxicité par ingestion (212 molécules) et l’irritation des voies respiratoires (206 molécules). À cela s’ajoutent 85 substances potentiellement mortelles en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Le benzène, hydrocarbure volatile présent dans l’ensemble des six échantillons, cristallise à lui seul plusieurs catégories de risques : cancérogène, mutagène, mortel en cas de pénétration dans les voies respiratoires, irritant pour la peau et les yeux.
Selon les données de Santé publique France citées dans le rapport, l’exposition aux microparticules inférieures à 2,5 micromètres serait responsable de 40 000 décès par an dans l’Hexagone et de 1 500 cas de cancers pulmonaires. Le Centre international de recherche sur le cancer classe d’ailleurs la pollution de l’air extérieur parmi les cancérogènes certains, notamment en raison des particules fines et des polluants qu’elles transportent.
Les écosystèmes aquatiques en péril
Au-delà des risques sanitaires, l’impact environnemental s’avère tout aussi préoccupant. L’étude recense 111 substances fortement toxiques pour les milieux aquatiques et 237 ayant des effets néfastes à long terme sur les écosystèmes. Une fois libérées par l’abrasion des pneus, les micro et nanoparticules contaminent le cycle de l’eau, la chaîne alimentaire et la qualité de l’air.
Les molécules identifiées possèdent par ailleurs un fort potentiel de bioaccumulation. Plusieurs études scientifiques récentes ont détecté la présence de microplastiques dans tous les fluides et organes humains testés ( sang, poumons, placenta, sperme, voire cerveau ). La taille réduite des nanoparticules leur permet de rester en suspension dans l’atmosphère et de pénétrer l’organisme par inhalation, ingestion ou contact cutané.
Il y a urgence à modifier la législation encadrant la fabrication et la commercialisation des pneus afin de limiter les risques pour les écosystèmes et les dangers sanitaires de ces molécules qui n’ont fait l’objet d’aucune évaluation sérieuse, insiste Stéphen Kerckhove, directeur général d’Agir pour l’environnement et membre du Conseil national de l’air.
Le secret industriel versus la transparence
La composition chimique des pneumatiques demeure aujourd’hui protégée par le secret industriel, privant consommateurs et autorités sanitaires d’informations. Pourtant, le règlement européen CLP impose aux fabricants de communiquer les dangers identifiés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, y compris aux utilisateurs finaux.
Pour remédier à un paradoxe réglementaire, Agir pour l’environnement formule six recommandations majeures : lever le secret industriel sur la composition chimique des pneus, interdire les substances les plus toxiques via le règlement REACH, relancer une enquête nationale de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire), créer un nouvel étiquetage européen intégrant un indicateur de toxicité, instaurer un système de bonus-malus selon la dangerosité, et mettre en place une autorisation de mise sur le marché tenant compte de la toxicité des composés.
Le rapport intervient dix-huit mois après une première étude d’Agir pour l’environnement, publiée en octobre 2024, qui avait démontré que les pneus testés perdaient entre 65 et 151 milligrammes de gomme par kilomètre parcouru, sous forme de milliards de micro et nanoparticules. Face à l’ampleur du phénomène, l’association plaide pour un durcissement de la norme Euro 7, actuellement jugée insuffisante pour encadrer les émissions particulaires issues de l’usure des pneumatiques. L’enjeu dépasse désormais la seule question des émissions de CO₂ : il s’agit de réguler une pollution invisible mais omniprésente, qui empoisonne silencieusement l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et les aliments que nous consommons.
Lire le rapport complet : « COMPOSITION DES PNEUS UN COCKTAIL TOXIQUE » – .PDF
Source : Agir Pour l’Environnemnet