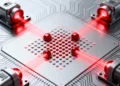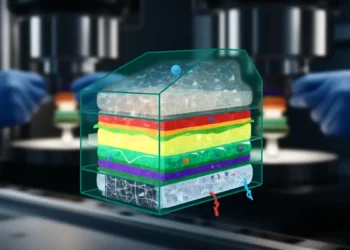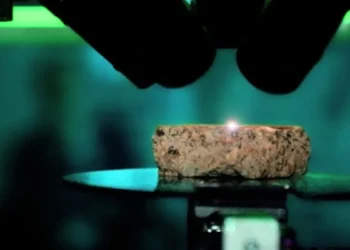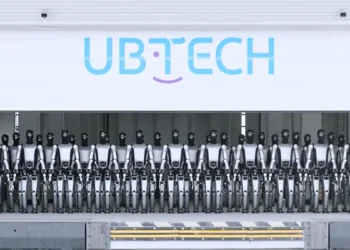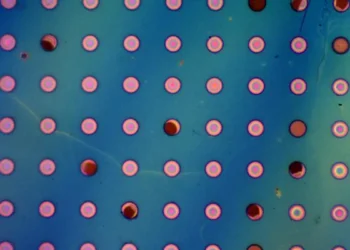Q.ANT, une jeune pousse installée à Stuttgart, vient d’annoncer une levée de 62 millions d’euros destinée à industrialiser des processeurs photoniques misant sur la lumière plutôt que sur les électrons. L’opération, conduite auprès d’un pool d’investisseurs privés dont le nom n’a pas été rendu public, permet au spécialiste allemand de disposer d’un capital suffisant pour passer des prototypes à la production en série et étoffer ses équipes, fortes d’un peu plus d’une centaine d’ingénieurs.
Fondée en 2018, la société mise sur une architecture baptisée LENA, acronyme de « Light Empowered Native Arithmetics ». Contrairement aux circuits traditionnels en silicium, composés de réseaux de transistors, la puce de Q.ANT orchestre le calcul à l’aide d’ondes lumineuses guidées dans un film mince de niobate de lithium sur isolant, ou TFLN. L’entreprise affirme obtenir, grâce à cette approche, un rendement énergétique trente fois supérieur à celui des processeurs graphiques les plus récents, tout en multipliant par cinquante la vitesse d’exécution sur des tâches d’intelligence artificielle et de calcul intensif.
« Nous voulons rendre les centres de données plus sobres et plus performants grâce à la photonique,» déclare Michael Förtsch, directeur général et cofondateur, dans un communiqué. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la consommation électrique des fermes de serveurs pourrait dépasser, d’ici 2026, les besoins annuels du Japon. Les projections les plus alarmistes évoquent jusqu’à 17% de la demande américaine totale à l’horizon 2030. Dans ce paysage, le moindre gain d’efficacité représente un argument de poids pour les opérateurs confrontés, à parts égales, à la flambée des tarifs de l’électricité et aux objectifs climatiques de leurs clients.
Un seul modulateur optique, logé sur moins d’un millimètre carré de TFLN, accomplit une multiplication 8 bits que le monde CMOS réalise habituellement à l’aide d’environ 1 200 transistors. Plus spectaculaire encore, une transformation de Fourier, opération indispensable dans l’analyse de signaux, la reconnaissance d’images ou la simulation numérique, se déploie avec un composant unique là où l’électronique empile plusieurs millions de portes logiques. À la clé : moins de chaleur à dissiper, donc une facture énergétique en chute libre et une empreinte carbone fortement réduite.
Le matériau au cœur de la plateforme, le niobate de lithium à couche mince, n’est pas vraiment nouveau : sa version en cristal massif équipe depuis des décennies les modulateurs implantés dans les réseaux de télécommunications longue distance. L’innovation réside dans l’amincissement extrême de la couche active — quelques centaines de nanomètres — collée sur un substrat de dioxyde de silicium ou de saphir. La démarche autorise un confinement optique serré, indispensable pour miniaturiser les guides d’ondes, et garantit une interaction électro-optique sans égale. Le résultat, détaille Q.ANT, se mesure par un taux d’extinction supérieur à 20 dB et une tension Vπ inférieure à 3,3 volts, des chiffres qui séduisent déjà opérateurs télécoms et chercheurs en calcul quantique.
John E. Bowers, professeur de photonique à l’Université de Californie, Santa Barbara, souligne : « Le TFLN conjugue perte optique minimale et bande passante gigantesque, deux paramètres clés pour rapprocher la lumière du processeur central. » D’autres jeunes pousses, Lightium ou HyperLight notamment, ont levé ensemble 44 millions de dollars depuis début 2024 afin d’explorer la même filière. L’effervescence se manifeste aussi chez les fondeurs historiques : Intel, GlobalFoundries et TSMC multiplient les annonces autour de plateformes mixtes combinant silicium photonics et matériaux ferro-électriques.
L’approche défendue par Q.ANT présente toutefois une particularité : la logique, longtemps séparée du transport d’informations optiques, est directement réalisée dans la matrice photonique. Grâce à une manipulation précise des longueurs d’ondes, la puce exécute plusieurs opérateurs en parallèle, atteignant des bandes passantes de plusieurs dizaines de gigahertz, quand l’électronique plafonne autour de quatre ou cinq gigahertz. Le composant se connecte à l’infrastructure existante via un bus PCI-Express et se glisse dans les baies standard 19 pouces. Les intégrateurs n’ont donc pas à repenser entièrement leur architecture.
Outre l’entraînement et l’inférence de réseaux neuronaux, la start-up vise l’analyse de séries temporelles pour la finance, le calcul de graphes massif pour la génomique, la simulation de matériaux ou l’optimisation logistique. Un premier kit de développement regroupant quatre unités d’exécution devrait sortir au premier trimestre 2026, suivi, six mois plus tard, d’une carte accélératrice abritant seize unités et d’un compilateur proche de l’API CUDA en usage dans l’écosystème Nvidia.
Le soutien des investisseurs s’accompagne d’un partenariat industriel avec Trumpf Photonic Components, maison mère de Q.ANT, qui fournira les chaînes de fabrication pilotées en salle blanche. Parallèlement, l’entreprise négocie l’installation d’une ligne pilote sur le campus de Stuttgart-Vaihingen afin de sécuriser l’ampleur croissante des commandes. D’après les documents transmis aux autorités boursières allemandes, le carnet affichait déjà plus de 40 millions d’euros d’engagements pour 2027, avant même l’annonce de la levée.
L’arrivée de la photonique intégrée remet en question le modèle dominant basé sur l’accroissement continu de la densité de transistors — la fameuse loi de Moore montre aujourd’hui ses limites physiques, entre dissipation thermique et coûts de gravure trans-finement. Q.ANT ne prétend pas remplacer l’électronique partout ; la société parie plutôt sur une hybridation permettant de confier aux photons les opérations linéaires gourmandes en énergie, et aux puces CMOS la gestion de tâches séquentielles.
À moyen terme, l’enjeu commercial se jouera autour de trois critères : la maturité industrielle du TFLN, la capacité à livrer des volumes conformes aux standards du cloud, et l’intégration logicielle dans les frameworks TensorFlow ou PyTorch. Pour Natalia Matskevich, analyste chez Gartner spécialisée dans les semi-conducteurs, « les décideurs adopteront le calcul photonique si le TCO (coût total de possession) chute d’au moins 50% sur cinq ans ; l’objectif paraît accessible au vu des gains énergétiques annoncés ».
Les prochains mois dévoileront la solidité du pari allemand. Les marchés ont déjà montré leur appétit pour des technologies allégeant l’empreinte carbone du numérique ; ils attendent désormais des livraisons effectives et des benchmarks publics. Si les chiffres internes se confirment sur des charges de travail réelles, Q.ANT pourrait bien donner un nouveau souffle à tout un pan de l’industrie du calcul haute performance, étendant la lumière hors des fibres pour la placer, enfin, au cœur du processeur.
Source : Q.ANT