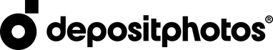Le charbon est le plus polluant des combustibles fossiles d’usage courant, aussi bien quand on considère les particules fines que les émissions de CO2. En mesurant pour chaque énergie le poids équivalent CO2 par tonne équivalent pétrole, le hit parade de l’Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe) est le suivant : nucléaire (19 kg), éolien (32), solaire photovoltaïque (316), gaz naturel (651), essence (830), diésel (856) et charbon (1123). La combustion du charbon dégage en outre du SH2, un gaz toxique qui contribue en outre à l’effet de serre. Le charbon est donc particulièrement coupable en matière d’émission de gaz à effet de serre, ces derniers étant, si on en croit l’immense majorité des scientifiques, les principaux responsables du changement climatique.
Nous n’en avons pas fini avec le charbon
Mais si écologiquement parlant, le charbon est la pire des énergies, il possède des qualités pratiquement irrésistibles. Il est abondant, disponible et bon marché. Hormis les énergies naturelles renouvelables, le charbon est la ressource la plus abondante et il est moins concentré, géographiquement, que le pétrole. Certes 60 % des réserves mondiales sont situés dans quatre pays seulement (Chine, États-Unis, Inde, Russie) qui ne représentent ensemble que 27% de la superficie des terres émergées et n’abritent que 40 % de la population mondiale), mais on en trouve dans presque tous les pays en plus ou moins grande quantité. Les réserves connues représentent 150 ans de besoins et près de 200 ans dans certains pays, une longévité bien supérieure à celle dont est généralement créditée le pétrole. En outre, c’est une énergie peu chère. Selon le C2ES (Centre de recherche indépendant sur le climat et l’énergie), un dollar de charbon permet de produire autant d’énergie que 6 dollars de pétrole ou de gaz naturel.
Comment s’étonner que de nombreux pays l’utilisent encore en tant que source d’énergie principale ? Le charbon assure en moyenne 40 % de la production mondiale d’électricité, mais cette proportion atteint 70 % en Inde et 80 % en Chine. La Chine consomme d’ailleurs presque la moitié du charbon utilisé dans le monde : 3,47 milliards de tonnes en 2011 selon l’Energy Information Administration (EIA) américaine, contre 3,9 milliards pour tous les autres pays réunis. En revanche, la consommation de l’OCDE a reculé, conséquence, notamment de la forte percée du gaz de schiste aux États-Unis qui a rendu le charbon moins compétitif dans ce pays.
La tendance lourde est globalement à la hausse. La consommation mondiale de charbon a augmenté de 5,4 % en 2011, ce qui fait du charbon le carburant fossile qui connaît la plus forte croissance. Hors OCDE, la consommation a même progressé de 8,4 %, en raison essentiellement des appétits chinois. Mais l’Agence internationale de l’énergie (AIE) est formelle : en 2017, la consommation mondiale de charbon représentera 4,32 milliards de tonnes équivalent pétrole, tout près des 4,4 milliards de TEP de l’or noir. Le charbon aura presque rattrapé le pétrole, environ soixante ans après avoir été lui-même dépassé par le pétrole.
Ce grand retour du charbon provoque évidemment interrogations et inquiétudes sur ses conséquences environnementales car les émissions de CO2 vont augmenter dans des proportions incompatibles avec les accords internationaux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Peut-on contenir les émissions ? La recherche sur le « charbon propre » ne pousse pas à l’optimisme. Elle avance lentement et trébuche souvent.
La piste du captage du CO2
La piste la plus explorée est le captage / stockage du CO2 (CSC). Le processus consiste à capturer le CO2 produit par de grandes installations fortement émettrices (centrales thermiques, usines, etc.). Le gaz est ensuite transporté pour être conservé dans des couches géologiques profondes, où les conditions de température et de pression permettent un stockage sous forme liquide. Le but est de l’isoler de l’atmosphère sur le long terme.
En décembre 2011, la feuille de route « Energies 2050 » de la Commission européenne, qui ambitionne de planifier la transition énergétique de l’Union vers le renouvelable, soulignait le rôle essentiel du CSC dans la décarbonisation de la production électrique et industrielle à l’horizon 2050 en Europe. Elle mettait en exergue deux enjeux prioritaires : la viabilité économique et la faisabilité sociétale. Ces deux points se révèlent très épineux.
Des expérimentations de stockage artificiel sont d’ores et déjà en cours. Plus de 20 projets commerciaux de CSC sont actuellement en cours de réalisation dans le monde. Environ 14 milliards de dollars sont alloués à ce jour à ces projets. En France, par exemple, après trois ans d’injection de 50 000 tonnes de CO2 en provenance des installations de Lacq , dans le puits de Rousse (sous-sol de Jurançon, Pyrénées-Atlantiques), le pétrolier Total a mis fin à la première phase du projet pilote en mars 2013. Le projet, opérationnel depuis janvier 2010, vise à tester une chaîne complète de captage-transport-stockage de CO2 industriel. Débute ensuite une phase de surveillance environnementale et de monitoring du réservoir, pour trois ans (2013-2016).
En Allemagne, en revanche, le scepticisme semble l’avoir emporté et l’abandon du seul projet de taille industrielle en Allemagne (Jänschwalde) illustre un facteur d’incertitude crucial pesant sur le développement de la filière CSC : l’acceptabilité sociale et environnementale. L’opposition porte sur les risques et impacts du stockage du CO2, en particulier à terre. En dehors de l’Union européenne, les Etats-Unis, l’Australie, la Norvège et le Canada sont très actifs en matière de développement du CSC. Une montée en puissance de la Chine est par ailleurs à l’œuvre.
Le principal inconvénient de cette technologie réside dans son coût extrêmement élevé. Comment quantifier les surcoûts ? Différents spécialistes s’y sont essayé (voir par exemple les calculs de Philippe Le Moal à partir de données allemandes). Leurs calculs donnent des résultats assez similaires. Pour les centrales électriques au charbon, les industriels devraient prévoir un surcoût de 40 % à 60 % du prix du mégawatt heure – un chiffre qui traduit aussi bien l’amortissement des investissements initiaux que les coûts en exploitation. Le surcoût associé à la mise en place du CSC est de 500 millions à 1 milliard d’euros pour une centrale à charbon « type », d’une puissance électrique supérieure à 250 MW. Ce coût ne peut être porté par les seuls investisseurs privés, d’autant moins quand le niveau du marché du carbone ne les y incite pas. Il faudra, soit d’autres dispositifs de soutien comme des tarifs fixes d’achat de l’électricité décarbonée, soit un prix plancher pour le CO2.
Faute d’un geste européen assez convaincant, de nombreux industriels ont retiré leurs projets du dispositif communautaire. Ils avancent une raison simple : la dégringolade du prix du carbone sur les marchés, de 15 euros la tonne en 2010 à 6,5 euros en 2013. La Commission européenne ne table plus que sur 1,3 à 1,5 milliard d’euros pour la vente d’une première tranche de 200 millions de quotas, au lieu de 5 milliards à l’origine. Elle ne pourra donc cofinancer que deux ou trois projets de CSC, bien loin des ambitions initiales. Il va sans dire que la condition sine qua non d’un projet européen de CSC, c’est une réforme majeure du marché des émissions de CO2.
La question gênante du changement d’échelle
À l’échelle planétaire, la séquestration géologique permettrait certes de réduire de 4 milliards de tonnes les émissions mondiales en 2050 (soit 10 % de l’effort de réduction auquel le monde s’est engagé) mais l’addition serait lourde : 900 milliards de dollars selon l’AIE. Les écologistes sont critiques. À leurs yeux, des financements considérables sont détournés de la recherche sur les énergies renouvelables comme l’éolien ou la géothermie. De plus, il faudra investir 25 % de plus en 2015 dans une centrale au charbon rien que pour la phase de captage du CO2. Sans oublier le transport du CO2, qui doit être acheminé vers les sites de stockage.
Une étude économique publiée en juillet 2009 par le Centre International de recherche sur l’environnement et le développement (CIRED) établissait qu’avec le CSC, le coût de la production d’énergie (coût en capital et en exploitation à hauteur de 7000 heures par an) est supérieur de 15 à 25 € par MWh à celui d’une centrale non équipée, ce qui représente un surcoût unitaire de 25 à 50%. Par conséquent, le coût d’abattement des émissions s’élève entre 25 et 45 € par tonne de CO2 évitée. Quant au coût de transport et stockage, il est supposé augmenter progressivement de 6 à 20 € par tonne de CO2 selon la quantité de CO2 déjà stockée.
De manière plus générale, les opposants hostiles à la poursuite de l’utilisation des énergies fossiles rechignent à financer une technologie qui pourrait prolonger leur usage. Greenpeace avait publié en mai 2008 un rapport sur la CSC intitulé False Hope (PDF). Sans rejeter le principe de la captation, l’ONG y observe qu’on ne peut pas démontrer l’efficacité, ni mesurer les résultats des méthodes de capture de carbone. Son argument : les émissions de CO2 prévues pour le milieu du XXIe siècle sont de l’ordre de 50 milliards de tonnes/an, or les expériences réalisées à ce jour concernent des quantités de quatre ordres de grandeur inférieures.
Les risques
Cette technologie présente des risques pour l’environnement : fuites de CO2 dans les sols, les nappes d’eau souterraines ou les fosses sous-marines, avec acidification de ces milieux. Les fuites accidentelles peuvent être mortelles pour les riverains, comme dans le cas du lac Nyos au Cameroun, où en 1986 l’émission d’une énorme bulle de CO2 suite à une éruption volcanique avait tué 1700 personnes et des milliers d’animaux dans un rayon de 25 km. De plus, l’augmentation du CO2 dans la partie peu profonde du sous-sol peut avoir des effets létaux sur les plantes et les animaux et contaminer les eaux souterraines.
Il faut maîtriser le stockage et s’assurer que, dans plusieurs centaines d’années, le CO2 séquestré ne va pas remonter en surface. À cet égard, le stockage du CO2 pose des dilemmes aussi sérieux que ceux rencontrés dans la gestion des déchets nucléaires. Technologiquement immature, le CSC doit encore apporter des garanties quant à la sécurité à long terme des réserves, à savoir leurs garanties d’étanchéités. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) souligne pour sa part qu’« il est nécessaire d’affiner les évaluations de stockage à l’échelle mondiale, régionale et locale et de mieux comprendre les phénomènes de confinement, de migration et de fuite à long terme. Pour répondre à ce dernier besoin, les techniques de surveillance et de vérification du comportement du CO2 injectés dans les formations géologiques doivent être perfectionnées.»
Une étude réalisée en Suisse par l’Office fédéral de l’énergie OFEN) met en lumière plusieurs risques : la modification des conditions de pression induite par l’injection de CO2 dans le sous sol pourrait accroître les risques sismiques, comme cela fut observé à Bâle fin 2006-début 2007, suite aux injections d’eau à des fins de géothermie profonde ; en cas de fuites, le CO2 s’échappant des couches géologiques pourrait former des acides qui dissolvent les métaux lourds, avec un risque de pollution des nappes phréatiques ; des fuites importantes de CO2 dans les sites de stockage pourraient provoquer une altération de la biodiversité en surface et dans la couche de terre proche de la surface ; suite à l’augmentation de sa densité, le CO2 pourrait s’accumuler dans des cuvettes en surface terrestre et, en cas de forte concentration, représenter un danger y compris pour l’homme. Enfin, l’injection de CO2 dans des aquifères salins pourrait, dans certaines conditions, libérer de l’eau salée qui remonterait dans les couches géologiques supérieures et polluerait les nappes phréatiques.
Bref, le retour en force du charbon et les débuts moins qu’enthousiasmants de la captation du CO2 renvoient à une question fondamentale : au nom de la lutte contre le réchauffement de la planète et en attendant une situation hypothétique où les énergies renouvelables auraient gagné la partie, quel est le risque le plus inacceptable : le nucléaire ou le CO2 ? Tant que la question n’est pas tranchée, il ne serait pas illogique que le risque CO2 soit encadré par une instance mondiale aussi efficace que l’AIEA, l’agence qui encadre le recours à l’énergie nucléaire. Et que soient signés, pour le CO2, des traités aussi contraignants que le traité de non-prolifération nucléaire (TNP).
[ Archive ] – Cet article a été écrit par Paristech