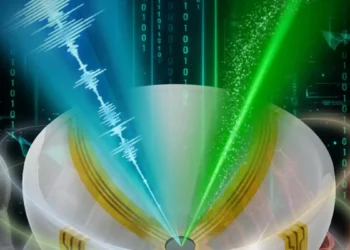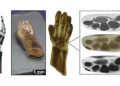Le pergélisol, sol gelé depuis au moins deux ans sous les régions froides de l’Arctique et des Alpes de l’hémisphère nord, couvre environ 17 % de la surface terrestre mondiale et stocke environ un tiers du carbone organique présent dans les sols à l’échelle mondiale. Le réchauffement climatique provoquant la fonte de ce pergélisol, le risque de libération de gaz à effet de serre (GES) suscite des inquiétudes quant au dépassement d’un point de basculement, qui déclencherait une boucle de rétroaction positive irréversible accélérant le réchauffement. Une question cruciale reste sans réponse : ces écosystèmes peuvent-ils conserver leur rôle de puits de GES dans un monde plus chaud ?
Une nouvelle étude publiée le 17 septembre dans Science Advances, menée par des chercheurs de l’Institut de physique atmosphérique de l’Académie chinoise des sciences, apporte une réponse décisive. Les recherches montrent qu’un réchauffement d’environ 2 °C renforce le puits de GES dans les écosystèmes du pergélisol arctique. Cependant, ce gain est largement compensé par un affaiblissement du puits de GES dans les régions alpines du pergélisol.
L’évaluation de la réponse nette des GES dans le pergélisol est notoirement complexe en raison de la forte hétérogénéité spatiale de ces paysages. « Nous avons intégré les données de 1 090 sites indépendants avec les réponses mesurées du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et de l’oxyde nitreux (N2O) au réchauffement expérimental dans les régions de pergélisol de l’hémisphère nord », a déclaré Bao Tao, premier auteur de l’étude qui a dirigé la synthèse des données.
L’étude a identifié les principales différences régionales qui déterminent cet équilibre :
Pergélisol alpin : situés à des altitudes plus élevées et à des latitudes plus basses, ces écosystèmes ont naturellement une faible teneur en eau dans le sol. Le réchauffement entraîne un assèchement supplémentaire du sol, ce qui affaiblit considérablement l’absorption du carbone par la photosynthèse et accélère les émissions de carbone.
Pergélisol arctique : ces écosystèmes, avec leurs sols plus humides et leur végétation plus dense, maintiennent une absorption de CO2 plus élevée. Le réchauffement augmente la teneur en eau du sol sous la surface, stimulant davantage l’absorption de CO2 et compensant en partie les émissions provenant de la décomposition du carbone du sol. La principale préoccupation ici est l’augmentation significative des émissions de CH4 provenant des sols gorgés d’eau.
La recherche a également mis en lumière le rôle souvent négligé de l’oxyde nitreux (N2O). Le réchauffement a entraîné une augmentation des émissions de N2O dans les régions alpines et arctiques. Bien que la quantité absolue soit faible, le dégel du pergélisol libère davantage d’azote disponible dans le sol, ce qui pourrait entraîner une augmentation considérable des émissions de N2O. Étant donné que le N2O a un potentiel de réchauffement global environ 273 fois supérieur à celui du CO2 sur un siècle, même de faibles augmentations peuvent avoir un impact disproportionné sur le climat.
« Maintenir le réchauffement supplémentaire en dessous de 2 °C dans les régions de pergélisol peut contribuer à éviter une rétroaction positive généralisée entre le pergélisol et le climat en général », a déclaré Xu Xiyan, auteur correspondant de l’étude. « Cependant, des mesures visant à atténuer le réchauffement des écosystèmes alpins de pergélisol sont urgentes afin de préserver leur fragile puits de carbone. »
Le GIEC a souligné que les rétroactions entre le pergélisol et le climat constituaient une incertitude majeure dans les bilans carbone mondiaux. « Nous souhaitons mettre en évidence les schémas et les mécanismes de réponse des gaz à effet de serre au réchauffement dans les écosystèmes de pergélisol, afin de fournir des données cruciales pour améliorer les projections climatiques », a ajouté Jia Gensuo, coauteur de l’étude.
Article : « Climate- carbon feedback tradeoff between Arctic and alpine permafrost under warming » – DOI : 10.1126/sciadv.adt8366
Source : Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences