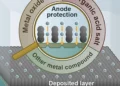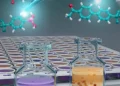L’hydrogène sera-t-il notre salut dans la course à la neutralité carbone ? C’est ce qu’on pourrait croire compte tenu de l’enthousiasme collectif. Et cet élan à la fois issu de la volonté politique – défini par une roadmap – et admis par les industriels est, à dire vrai, une bonne nouvelle. Car ce n’est qu’à la double condition d’une rencontre entre ces deux mondes que le déploiement de l’hydrogène peut être espéré. Toutefois, il doit être reconnu comme une évolution du temps long, non comme un virage abrupt à opérer, et surtout entrepris sans précipitation, même si le contexte est alarmiste.
Plus que l’objectif de moyens, c’est l’objectif de résultats qui doit être visé. Et le cap que nous nous sommes collectivement fixé est clair à horizon 2035. Implique-t-il nécessairement des ruptures comme elles sont souvent souhaitées avec les moteurs à combustion internes ? Peut-être pas. Il faut plutôt raisonner en termes d’évolutions technologiques au profit du volet RSE et être vigilant surtout à l’échelle géologique que nous défions chaque fois un peu plus, à cause de la vitesse et de l’impact de nos innovations. C’est le fameux effet papillon. Il faut être fin dans nos approches. Plus que la stratégie massive des à-coups, pourquoi ne pas faire l’éloge du bon sens dans la transition énergétique ?
L’hydrogène est un vecteur de survie dans une économie qui a été façonnée par les énergies fossiles, dont on sait qu’elles se tariront un jour. L’hydrogène est aussi un vecteur d’espoir dans un cadre réglementaire qui nous oblige aujourd’hui à repenser la mobilité. L’hydrogène dans les deux cas est une opportunité mais ce n’est qu’un levier parmi d’autres à considérer dans l’éventail énergétique pour atteindre nos objectifs de décarbonation et de souveraineté. Elle n’est pas une solution miracle mais une solution à plébisciter dans des cas singuliers qui l’imposent.
Surtout, il est impératif que chacune des technologies choisies pour accompagner la transition énergétique soit éprouvée et challengée c’est-à-dire poussée jusqu’au bout de sa possibilité afin d’en éprouver la limite, de manière à savoir où l’optimisation se situe. Ce procédé pourra alors être le point de départ d’une mobilité décarbonée. Et ce, qu’il s’agisse de batteries ou de piles à combustible, de mobilité douce ou lourde, ou encore pour des applications off highway (maritimes, ferroviaires…).
Aujourd’hui la technologie est presque sans limite et démontrer qu’elle est exploitable dans un environnement ou une application extrême n’est plus aussi complexe. Ce sont des critères de faisabilité, reproductibilité et durabilité qui doivent être interrogés en plus de la question des coûts et de l’accessibilité. Pousser le moteur d’une 2 CV à la puissance d’une Ferrari est bien évidemment possible mais cela a-t-il du sens ?
Prenons l’exemple de la pile à combustible : le mode d’utilisation le plus adéquat est le prolongateur d’autonomie parce que c’est un point de fonctionnement stabilisé optimum pour la pile qui permet de garantir à la fois un bon rendement et une durée de vie satisfaisante. C’est ce qui justifie que les bus, camions et trains soient de bons candidats à l’hydrogène. A contrario, la voiture individuelle, comme elle subit des changements de régime de couple fréquents, met la technologie sous contrainte. Il n’est pas impossible de l’appliquer au véhicule individuel, cela a été fait (Toyota, Hyundai, Honda, Mercedes, etc.) mais à quel prix ?
Il est des situations aussi dans lesquelles il sera inconséquent de forcer l’utilisation de la batterie électrique parce que les moyens de recharge ou l’infrastructure ne seront pas adéquats, il faudra donc opter pour la flexibilité de l’hydrogène. Le contexte et l’environnement d’application doivent être la norme pour décider de l’usage de l’hydrogène ou de la batterie électrique. Et ne perdons pas de vue que l’un ne vaut pas l’autre, simplement parce qu’ils ne sont pas comparables. L’hydrogène n’est pas un mode ni même une source d’énergie, contrairement à la batterie, mais un vecteur d’énergie. Aujourd’hui, il n’existe pas de méthodologie de calcul holistique qui permette d’attester d’un bilan global, de la production des matières premières jusqu’à la fin de vie du véhicule, et de quantifier l’impact des émissions de CO₂ en fonction du mode d’énergie choisi.
La logique du meilleur rendement, selon le principe from well to wheel, induit une baisse des transformations énergétiques intermédiaires. Mais elle n’est pas défendable à tout crin.
On ne peut pas équiper tous les véhicules avec des batteries à gogo au risque d’engréver l’application elle-même. En prenant l’exemple d’un camion, l’objectif est de ne pas modifier l’usage du véhicule en sacrifiant la charge utile au profit de lourdes batteries présentes dans le tracteur.
Hydrogène ou batterie, l’utilisation doit toujours être au cœur des réflexions, sans céder à la surenchère technologique ou à la mise en compétition absurde d’énergies.
Aujourd’hui il faut réfléchir à rendre l’hydrogène le plus accessible possible en unissant nos forces entre industriels pour réduire les coûts initiaux, le rendre abordable tant dans sa production que dans son usage. Et donc, il y a des grands groupes qui se sont saisi du sujet en se posant les bonnes questions pour investir durablement : comment transférer une technologie éprouvée dans l’aérospatiale et l’étendre à un usage quotidien sur la route ? Et finalement l’ensemble des industriels s’est mis autour de la table pour résoudre l’équation à deux inconnues : comment utiliser l’hydrogène s’il n’est pas produit ? Pourquoi en produire tant qu’on ne l’utilise pas ? Et plus on avance dans le temps, plus on arrive à faire converger tous les acteurs vers un point de rencontre.
Le déploiement de l’hydrogène doit être guidé par le cap environnemental et renforcé par des actions collectives et inspirées à la fois sur la production et l’usage. Nous, équipementier automobile, avons à cœur de développer des solutions technologiques standardisées qui soutiennent cette impulsion RSE. Et c’est en convoquant des principes de bon sens que nous réfléchissons en particulier à l’allègement des produits. À cela, nous conjuguons le mode suggestif plutôt que directif pour accompagner nos interlocuteurs dans ces changements.
Avons-nous donc le temps ? Ce que nous expérimentons tient en réalité non pas du virage à 180° mais de l’évolution technologique cohérente. Et cette fois-ci, nous nous préoccupons enfin, et il était temps !, de la planète. Veillons à ne pas amplifier le dérèglement de la machine, par des actions conduites dans l’urgence (pour apaiser la désagréable sensation que nous avons déjà overshooté la trajectoire) sans réflexion globale qu’il faut prendre le temps de bien poser afin de choisir le cap optimum. Car se précipiter sur les leviers tels que la batterie et l’hydrogène sans avoir travaillé sur les causes racines de la dépense énergétique ne pourrait représenter qu’une avancée réduite dans l’exploitation responsable de ces technologies. Le seul changement, dès à présent, doit être celui de l’usage et de la masse à mettre en mouvement à chaque déplacement.
Yohann Perrot, directeur innovation du groupe Bontaz