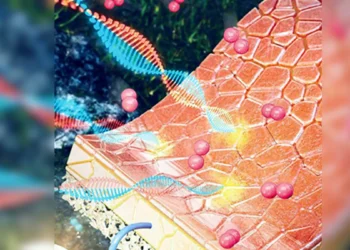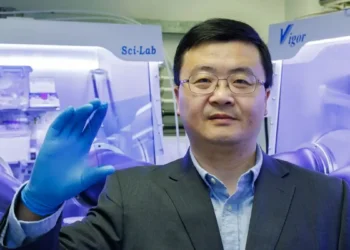Un décryptage de Florent Thouminot, directeur général de Methagora
Les premiers méthaniseurs valorisant le biogaz par cogénération ont été construits entre 2008 et 2022. Aujourd’hui, au nombre de 1101 sur tout le territoire, ces installations sont à la fois perçues comme vieillissantes et peu rentables tant en termes de rendement énergétique que de gain financier pour les exploitants. Historiquement plébiscitées pour la production d’électricité et de chaleur, elles sont aujourd’hui délaissées par l’État qui encourage plutôt les exploitants agricoles en cogénération à transitionner au profit de l’injection de biométhane. Alors que l’État vient de promulguer l’arrêté du 8 septembre 2025* actant ces orientations, Florent Thouminot, directeur général de Methagora, décrypte ce changement de paradigme et ce qu’il implique pour les exploitants agricoles.
Pourquoi la règlementation devient favorable à la transition de la cogénération à l’injection du biométhane ?
Déjà, que les exploitants se rassurent, l’État a affirmé qu’aucune pénalité ne serait appliquée à ceux qui souhaitent s’extraire de la cogénération au profit de l’injection de biométhane. Cela signifie que les exploitants n’auront pas à rembourser des aides publiques ou rompre des contrats d’insertion. Il s’agit donc bien de faciliter la transition et non d’affirmer une rupture. Surtout l’État affirme clairement son soutien à l’injection du biométhane puisqu’il met fin aux subventions concernant la production d’énergie produite par cogénération pour les nouvelles installations construites.
Pour autant, il ne s’agit pas d’opposer injection et cogénération. Cette dernière reste une solution techniquement pertinente qui a bon nombre d’avantages (flexibilité, non-intermittence, synergies agricoles). Mais dans le contexte politique, énergétique, et géopolitique actuel, il apparaît nettement que la cogénération ne sera plus soutenue. Or une filière qui cesse d’être soutenue, c’est une filière où les investissements, les innovations et les compétences déclinent. C’est ce constat qu’il faut partager.
Les signaux sont là, fléchant davantage vers l’injection. Pourquoi ? Car le biométhane est le seul à avoir à la capacité notable de produire du gaz renouvelable se substituant au gaz fossile, avec l’enjeu de décarboner et relocaliser les 400TWh de consommation annuelle en France. Actuellement, 14,3TWh de gaz vert sont produits en France, les installations de cogénération représenteraient une capacité supplémentaire potentielle allant jusqu’à 10 TWh.
Pour les exploitants, il ne faut pas subir ce mouvement mais l’anticiper car transformer une installation existante est un projet en soi, long, technique, coûteux et exigeant. Il ne s’improvise pas, il se prépare. Et c’est précisément notre rôle d’en faciliter chaque étape, sans précipitation, mais avec lucidité et méthode.
Quels sont aujourd’hui les freins perçus à la conversion et peut-on faire contrepoids pour rassurer les exploitants agricoles ?
Lorsqu’un exploitant agricole produit de l’énergie via la cogénération, il bénéficie d’un contrat d’achat garanti par l’État, qui lui offre une sécurité financière. En basculant vers l’injection de biométhane, cette sécurité disparaît puisqu’il faut dès lors conclure des contrats de droit privé, souvent en gré à gré, avec des fournisseurs ou des acheteurs de gaz. Cela peut générer des inquiétudes légitimes, car l’équilibre économique repose sur la capacité à vendre l’intégralité de la production pour rentabiliser ses investissements. Et qui plus est, passer à l’injection de biométhane nécessite souvent plusieurs millions d’euros de réinvestissement (épuration, raccordement). Or, tous les agriculteurs n’ont pas la capacité financière ou le souhait de se lancer dans un tel projet, ni de perdre en indépendance en cédant la propriété de leur organe de transformation pour réduire leurs frais. Dernier point, la cogénération, en plus de l’électricité, produit de la chaleur.
Lors du passage à l’injection, cette production de chaleur disparaît, ce qui peut poser problème dans les installations où elle était utilisée (séchage, réseaux de chaleur communaux, etc.) et représenter un manque à gagner. Dans ce cas de figure, il va s’agir d’identifier des solutions alternatives.
Face à ces constats, une partie de la solution se trouve, de mon point de vue, dans la mutualisation proposée par un intermédiaire. De prime abord, cela peut dérouter voire effrayer de recourir à un tiers mais l’avantage réside clairement dans sa capacité à, premièrement, tamponner le risque en agrégeant plusieurs installations (de 5 à 6 en moyenne), deuxièmement, à porter directement l’investissement sur le nouvel équipement.
Ce faisant, parce que l’intermédiaire gère du volume via diverses installations, qu’il a de l’expérience dans la contractualisation et négocie en direct avec les acheteurs de gaz, il garantit sécurité et durabilité à l’exploitant, tout en lui apportant une expertise sur des aspects techniques complexes. En plus, sa mission porte aussi sur la défense des intérêts de l’exploitant, pour faire valoir les spécificités agricoles dans un univers gazier peu habitué au biométhane.
C’est en fait un accompagnement hybride, à la fois technique, économique et humain, qui doit être perçu comme un vrai levier de développement agricole, en complément de l’activité principale, pour stabiliser ses revenus et participer à maintenir l’équilibre économique local.
Comment savoir si un exploitant est éligible pour faire évoluer son installation de cogénération ?
Ce qui est certain c’est qu’il s’agit de transformations majeures, avec des engagements longue durée (15 ans), aux enjeux économiques et techniques conséquents. Sur un projet de méthanisation, une erreur peut coûter cher ; il est donc crucial de prendre le temps de comprendre les enjeux, les risques et les opportunités.
Avant tout engagement, nous réalisons un audit complet de l’installation de méthanisation : état technique, performance économique, potentiel d’évolution, contexte local… Cet état des lieux est indispensable pour déterminer s’il est pertinent d’envisager une conversion vers l’injection, et sous quelles conditions. Il nous sera possible de refuser un projet par exemple lorsqu’aucune solution cohérente ne peut être proposée.
Par ailleurs, notre modèle repose sur une volonté d’inclusion maximale. Nous avons fait le choix de ne pas nous limiter aux cas les plus « faciles » (installations >500 kWe à proximité du réseau). Grâce au gaz porté, nous accompagnons aussi les installations de plus « petite » taille, dès 250 kWe, éloignées du réseau, qui représente en réalité la taille médiane des installations de cogénération en France.
Notre philosophie reste vraiment de proposer des solutions sur-mesure à des exploitants qui n’en trouveraient pas seuls et d’adapter notre ingénierie à la diversité du terrain.
*Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute