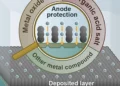Une équipe japonaise vient de lever l’un des principaux verrous de la filière hydrogène, son stockage sûr et réversible. Dévoilée le 18 septembre dans Science, leur « batterie » fonctionne à seulement 90 °C, loin des 300–400 °C exigés jusqu’ici pour libérer le gaz. L’appareil mise sur un électrolyte solide inédit, capable de conduire des ions hydrure avec une aisance record, et sur le magnésium hydrure comme matériau d’électrode. De quoi rapprocher l’hydrogène d’applications concrètes, des transports à l’industrie.
L’électrolyte qui change la donne
Cryogéniser l’H₂ à −252,8 °C ou le comprimer à 700 bar alourdit son bilan énergétique. Stocké sous forme solide, le magnésium hydrure (MgH₂) pourrait renfermer jusqu’à 7,6% de son poids en hydrogène, mais il fallait jusqu’ici dépasser 300 °C pour l’absorber ou le libérer. Les ingénieurs manquaient donc d’une solution à la fois compacte, sûre et peu énergivore.
Le cœur de l’innovation est un cristal qui laisse circuler les ions hydrure (H⁻) avec une conductivité dès la température ambiante. Inséré entre une anode MgH₂ et une cathode H₂, il permet un stockage-déstockage complet à 90 °C, atteignant la capacité théorique de 2 030 mAh g⁻¹ sur plusieurs cycles.
« Nous avons démontré le fonctionnement d’une batterie Mg-H₂ sûre et efficace, avec haute capacité, basse température et absorption/dégagement réversible de l’hydrogène », précise Naoki Matsui.
Un potentiel industriel à large spectre
La baisse drastique des exigences thermiques ouvre enfin la voie à l’embarquement d’un réservoir d’hydrogène dans les véhicules légers comme dans les engins utilitaires lourds. En réduisant les contraintes de refroidissement et d’isolation, la nouvelle batterie facilite l’intégration du stockage directement à bord, sans sacrifier le volume utile ni alourdir excessivement la chaîne de traction. Les constructeurs peuvent ainsi envisager des architectures plus compactes, tout en préservant l’autonomie et la sécurité nécessaires aux applications routières ou logistiques les plus exigeantes.
Sur le plan des réseaux énergétiques, le dispositif se marie naturellement à l’électrolyse alimentée par des sources renouvelables. En absorbant l’hydrogène excédentaire lorsque le vent souffle ou que le soleil brille, puis en le restituant lors des pointes de demande, la batterie joue le rôle de tampon qui fait défaut aux systèmes électriques intermittents. Cette fonction de stockage intermédiaire, assurée à une température modérée, limite les pertes d’énergie et simplifie la gestion opérationnelle des infrastructures, des micro-grids insulaires jusqu’aux réseaux nationaux.
Enfin, son format de type « batterie » constitue un atout majeur pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Les fabricants, déjà rompus aux procédés de production et de contrôle qualité des accumulateurs lithium-ion, peuvent adapter leurs lignes avec un minimum d’investissements supplémentaires.
Le coût des précurseurs baryum-calcium-sodium et la durabilité au-delà de quelques dizaines de cycles restent à optimiser. « Ces propriétés étaient inatteignables avec les électrolytes liquides classiques ; nous posons les bases d’un vecteur hydrogène réellement efficace », souligne Takashi Hirose.
Article : « High-Capacity, Reversible Hydrogen Storage Using H–-Conducting Solid Electrolytes » – Journal : Science – DOI : 10.1126/science.adw1996
Source : Institut des sciences du Tokyo