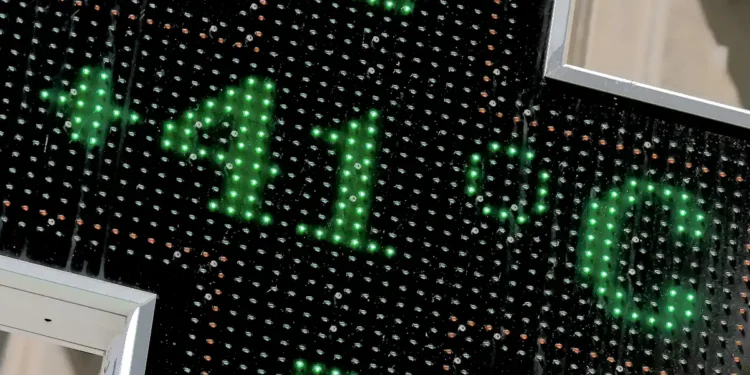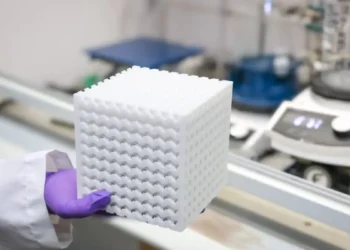François Lévêque, Mines Paris – PSL
Depuis 2003, l’Europe a réalisé des progrès conséquents dans l’adaptation aux vagues de chaleur : en proportion, on meurt moins, même si les températures sont plus élevées. Et demain ?
La chaleur tue : on a recensé plusieurs centaines de décès à Paris ainsi que dans d’autres grandes capitales européennes lors de la canicule de mi-juin à début juillet 2025. Le nombre de morts aurait triplé par rapport à la normale du fait du changement climatique, selon une estimation réalisée par des chercheurs britanniques.
Ces chiffres font peur. Ils masquent cependant les grands progrès réalisés pour limiter notre vulnérabilité face à la multiplication des vagues de chaleur. La chaleur tue mais de moins en moins, grâce à nos actions individuelles et collectives d’adaptation. Il faut s’en féliciter, et non l’ignorer.
Les données d’observation de mortalité par les agences sanitaires n’étant pas encore disponibles, le calcul qui précède repose sur des modèles et des méthodes, connus des spécialistes. La plupart sont désormais suffisamment au point pour rendre compte en confiance de leurs résultats sur les progrès de l’adaptation.
La canicule de 2003, ou l’Année zéro
Commençons notre examen en prenant pour point de repère la canicule de 2003 en France. Cet été-là le pays a connu une véritable hécatombe : près de 15 000 décès en excès.
En contrecoup, les pouvoirs publics ont décidé toute une série d’actions préventives pour protéger la population des grandes chaleurs : mise en place d’un système d’alerte annonçant les canicules, campagnes d’information auprès du public sur les façons de se protéger, formation du personnel de santé, ouverture d’espaces climatisés dans les maisons de retraite et les services hospitaliers, etc.
Quelques années plus tard, une équipe regroupant des chercheurs de l’Inserm, de Météo France et de Santé publique France s’est demandé si ces mesures avaient bien été suivies d’effet. À partir d’un modèle reliant mortalité et températures observées en France sur vingt-cinq ans, ils ont estimé que la canicule de l’été 2006 s’était traduite par une baisse de plus de moitié du nombre de décès en excès.
Ce progrès ne peut pas, bien sûr, être imputé aux seules actions publiques. La canicule de 2003 a été à l’origine d’une prise de conscience généralisée des méfaits de la chaleur, de changement des comportements individuels et d’achat d’appareils de rafraîchissement, tels que ventilateurs et climatiseurs, mais aussi d’équipements plus innovants apparus plus tard sur le marché, comme les rafraîchisseurs d’air ou les pompes à chaleur réversibles.
Attention, le frigidaire distributeur de glaçons ne fait pas partie de cette panoplie ! En cas de fortes températures, il faut éviter de boire de l’eau glacée pour se rafraîchir. Elle ralentit la sudation, mécanisme fondamental de l’organisme pour lutter contre la chaleur.
Pourquoi il est délicat de comparer 2022 et 2003
L’été 2022 a constitué la seconde saison la plus chaude jamais enregistrée dans l’Hexagone. Le nombre de décès en excès a été toutefois cinq fois moindre que celui de 2003, mais on ne sait pas précisément quelle part de cette baisse est simplement due à des conditions caniculaires un peu moins défavorables.
La comparaison 2003/2022 est tout aussi délicate au niveau européen. On dispose bien, à cette échelle, de travaux d’estimation de la surmortalité en lien avec la chaleur aux deux dates, mais ils reposent sur des méthodes différentes qui rendent leurs résultats peu comparables : 74 483 décès pour la canicule de 2003 en Europe contre 61 672 morts lors de la canicule de 2022.
En effet, le premier chiffre mesure des décès en excès par rapport à une période de référence, tandis que le second découle de l’application d’une méthode épidémiologique. Celle-ci, plus sophistiquée, mais aussi plus rigoureuse, consiste à estimer pour une ville, une région ou un pays, le risque de mortalité relatif en fonction de la température, à tracer une « courbe exposition-réponse », selon le jargon des spécialistes.
Pour l’Europe entière, le risque est le plus faible autour de 17 °C à 19 °C, puis grimpe fortement au-delà. Connaissant les températures journalières atteintes les jours de canicule, on en déduit alors le nombre de décès associés à la chaleur.
Quelles canicules en Europe à l’horizon 2050 ?
Résumé ainsi, le travail paraît facile. Il exige cependant une myriade de données et repose sur de très nombreux calculs et hypothèses.
C’est cette méthode qui est employée pour estimer la surmortalité liée aux températures que l’on rencontrera d’ici le milieu ou la fin de ce siècle, en fonction, bien sûr, de différentes hypothèses de réchauffement de la planète. Elle devrait par exemple être décuplée en Europe à l’horizon 2100 dans le cas d’un réchauffement de 4 °C.
Ce chiffre est effrayant, mais il ne tient pas compte de l’adaptation à venir des hommes et des sociétés face au réchauffement. Une façon de la mesurer, pour ce qui est du passé, consiste à rechercher comment la courbe exposition-réponse à la température se déplace dans le temps. Si adaptation il y a, on doit observer une mortalité qui grimpe moins fortement avec la chaleur qu’auparavant.
C’est ce qui a été observé à Paris en comparant le risque relatif de mortalité à la chaleur entre la période 1996-2002 et la période 2004-2010. Aux températures les plus élevées, celles du quart supérieur de la distribution, le risque a diminué de 15 %.
Ce chiffre ne semble pas très impressionnant, mais il faut savoir qu’il tient uniquement compte de la mortalité le jour même où une température extrême est mesurée. Or, la mort associée à la chaleur peut survenir avec un effet de retard qui s’étend à plusieurs jours voire plusieurs semaines.
La prise en compte de cet effet diminue encore le risque entre les deux périodes : de 15 % à 50 %. Cette baisse de moitié est plus forte que celle observée dans d’autres capitales européennes comme Athènes et Rome. Autrement dit, Paris n’est pas à la traîne de l’adaptation aux canicules.
De façon générale et quelle que soit la méthode utilisée, la tendance à une diminution de la susceptibilité de la population à la chaleur se vérifie dans nombre d’autres villes et pays du monde développé. L’adaptation et la baisse de mortalité qu’elle permet y est la règle.
La baisse de la mortalité en Europe compensera-t-elle l’augmentation des températures ?
C’est une bonne nouvelle, mais cette baisse de la surmortalité reste relative. Si les progrès de l’adaptation sont moins rapides que le réchauffement, il reste possible que le nombre de morts en valeur absolue augmente. En d’autres termes, la mortalité baisse-t-elle plus vite ou moins vite que le réchauffement augmente ?
Plus vite, si l’on s’en tient à l’évolution observée dans dix pays européens entre 1985 et 2012. Comme ces auteurs l’écrivent :
« La réduction de la mortalité attribuable à la chaleur s’est produite malgré le décalage progressif des températures vers des plages de températures plus chaudes observées au cours des dernières décennies. »
En sera-t-il de même demain ? Nous avons mentionné plus haut un décuplement en Europe de la surmortalité de chaleur à l’horizon 2100. Il provient d’un article paru dans Nature Medicine qui estimait qu’elle passerait de 9 à 84 décès attribuables à la chaleur par tranche de 100 000 habitants.
Mais attention : ce nombre s’entend sans adaptation aucune. Pour en tenir compte dans leurs résultats, les auteurs de l’article postulent que son progrès, d’ici 2100, permettra un gain de mortalité de 50 % au maximum.
Au regard des progrès passés examinés dans ce qui précède, accomplis sur une période plus courte, une réduction plus forte ne semble pourtant pas hors de portée.
Surtout si la climatisation continue de se développer. Le taux d’équipement d’air conditionné en Europe s’élève aujourd’hui à seulement 19 %, alors qu’il dépasse 90 % aux États-Unis. Le déploiement qu’il a connu dans ce pays depuis un demi-siècle a conduit à une forte baisse de la mortalité liée à la chaleur.
Une moindre mortalité hivernale à prendre en compte
Derrière la question de savoir si les progrès futurs de l’adaptation permettront de réduire la mortalité liée à la chaleur de plus de 50 % en Europe, d’ici 2100, se joue en réalité une autre question : la surmortalité associée au réchauffement conduira-t-elle à un bilan global positif ou bien négatif ?
En effet, si le changement climatique conduit à des étés plus chauds, il conduit aussi à des hivers moins rudes – et donc, moins mortels. La mortalité associée au froid a été estimée en 2020 à 82 décès par 100 000 habitants. Avec une élévation de température de 4 °C, elle devrait, toujours selon les auteurs de l’article de Nature Medicine, s’établir à la fin du siècle à 39 décès par 100 000 personnes.
Si on rapporte ce chiffre aux 84 décès par tranche de 100 000 habitants liés à la chaleur, cités plus haut, on calcule aisément qu’un progrès de l’adaptation à la chaleur de 55 % suffirait pour que la mortalité liée au froid et à la chaleur s’égalisent. Le réchauffement deviendrait alors neutre pour l’Europe, si l’on examine la seule mortalité humaine liée aux températures extrêmes.
Mais chacun sait que le réchauffement est aussi à l’origine d’incendies, d’inondations et de tempêtes mortelles ainsi que de la destruction d’écosystèmes.
Sous cet angle très réducteur, le réchauffement serait même favorable, dès lors que le progrès de l’adaptation dépasserait ce seuil de 55 %. Si l’on ne considère que le cas de la France, ce seuil est à peine plus élevé : il s’établit à 56 %.
Des conclusions à nuancer
La moindre mortalité hivernale surprendra sans doute le lecteur, plus habitué à être informé et alarmé en période estivale des seuls effets sanitaires négatifs du réchauffement. L’idée déroutante que l’élévation des températures en Europe pourrait finalement être bénéfique est également dérangeante. Ne risque-t-elle pas de réduire les motivations et les incitations des Européens à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre ?
C’est peut-être cette crainte qui conduit d’ailleurs les auteurs de l’article de Nature Medicine à conclure que :
« La mortalité nette augmentera substantiellement si l’on considère les scénarios de réchauffement les plus extrêmes et cette tendance ne pourra être inversée qu’en considérant des niveaux non plausibles d’adaptation. »
Notons également que ces perspectives concernent ici l’Europe. Dans les pays situés à basse latitude, la surmortalité liée aux températures est effroyable. Leur population est beaucoup plus exposée que la nôtre au changement climatique ; elle est aussi plus vulnérable avec des capacités d’adaptation qui sont limitées par la pauvreté.
À l’horizon 2100, la mortalité nette liée aux températures est estimée à plus de 200 décès pour 100 000 habitants en Afrique sub-saharienne et à près de 600 décès pour 100 000 habitants au Pakistan.
Concluons qu’il ne faut pas relâcher nos efforts d’adaptation à la chaleur en Europe, quitte à ce qu’ils se soldent par un bénéfice net. Les actions individuelles et collectives d’adaptation à la chaleur sauvent des vies. Poursuivons-les. Et ne relâchons pas pour autant nos efforts de réduction des émissions, qui sauveront des vies ailleurs, en particulier dans les pays pauvres de basses latitudes.
François Lévêque a publié, avec Mathieu Glachant, Survivre à la chaleur. Adaptons-nous, Odile Jacob, 2025.
François Lévêque, Professeur d’économie, Mines Paris – PSL
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.