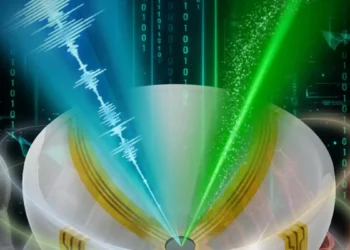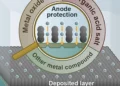Gaëtan Brisepierre, École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
Et si le confort thermique en automne et en hiver n’était pas seulement une affaire de thermostat ? Une expérimentation sociale menée avec un groupe de ménages volontaires ouvre des perspectives intéressantes. Cette approche, pour être utile, ne doit bien entendu pas se substituer à l’impératif de rénovation énergétique du parc immobilier, mais la compléter. Elle explore ainsi une autre piste : celle d’une sobriété choisie plutôt que contrainte.
Alors que les Français viennent de rallumer le chauffage, que reste-t-il des deux années de sobriété énergétique que nous venons de vivre ? Souvenez-vous : en 2022, face au conflit en Ukraine et à ses répercussions sur le prix de l’énergie, le gouvernement lui-même demandait aux entreprises et aux citoyens de limiter la thermostat à 19 °C.
Même si une majorité de ménages déclare désormais se chauffer à 19 °C ou moins, la mise en pratique d’une véritable sobriété thermique reste encore limitée, voire assimilée à la précarité énergétique – qui reste toutefois un enjeu clé et une réalité vécue par plus d’un Français sur cinq.
Pourtant, il est possible, à certaines conditions, de passer l’hiver à une température comprise entre 14 °C et 18 °C chez soi, et même d’éteindre le chauffage, tout en se sentant bien.
L’hiver dernier, une quinzaine de familles ont tenté l’aventure du programme Confort sobre, accompagnés par un designer énergétique. Cette expérimentation a donné lieu à une étude sociologique et qui fera prochainement l’objet d’une publication scientifique.
Bien vivre à moins de 19 °C
Aucune de ces familles, toutes en chauffage individuel, n’envisage désormais de revenir à ses anciennes habitudes de chauffage. Les baisses de consommation d’énergie, mesurées par les ménages eux-mêmes, sont loin d’être le seul bénéfice perçu.
Les participants ont mis en avant un mieux-être lié à une ambiance plus fraîche : qualité du sommeil, moins de fatigue, réduction des maladies hivernales… Ils ont également valorisé l’autonomie gagnée en étant moins dépendants du chauffage, et se sentent ainsi mieux préparés aux crises à venir.
Ces ménages ayant fait le choix de s’engager dans un programme de sobriété ne sont pas forcément des « écolos extrémistes ». Certains avaient déjà, avant l’expérience, multiplié les actions pour réduire leur budget énergie, et voulaient voir s’il était possible d’aller plus loin sans perdre en confort. D’autres – parfois les mêmes – étaient dans un parcours de transformation écologique de leur mode de vie et voulaient réduire l’impact de leur consommation de chauffage.
Le confort sobre : qu’est-ce que c’est ?
Le programme de sobriété ici expérimenté est une déclinaison adaptée aux particuliers de la « Méthode Design énergétique », inventée par Pascal Lenormand, déjà éprouvée dans des bâtiments du secteur tertiaire.
L’expression « confort sobre », utilisée pour nommer le programme, a contribué au vif intérêt qu’il a suscité : plus de 500 candidatures reçues ! Cet oxymore permet de contourner l’imaginaire de privation associé à la sobriété. A la fin du programme, il faisait partie du langage courant des participants.
Concrètement, les ménages sont été suivis pendant un hiver, avec cinq rendez-vous en visioconférence animés par Pascal Lenormand. Entre chaque visio, ils étaient invités à expérimenter de nouvelles pratiques chez eux à travers des missions bien plus larges que les habituels écogestes, par exemple, mieux isoler son propre corps en s’habillant différemment. Plusieurs « périodes d’entraînement » successives et progressives les ont encouragés à acquérir une posture d’expérimentateurs de leur propre confort.
Un groupe WhatsApp a été mis en place par l’équipe pour permettre aux participants de s’approprier collectivement l’expérience. À l’issue du programme, les participants ont décidé de le prolonger. Cette dynamique entre pairs a fortement soutenu les efforts de sobriété thermique, même si la radicalité de certains participants a pu en marginaliser d’autres, comme on l’illustrera plus loin.
Et dans la pratique ?
Les nouvelles pratiques adoptées par les ménages ont suivi la logique progressive prévue par le programme. La mesure des températures et des consommations d’énergie a fourni un bon point de départ. Souvent réalisé avec les moyens du bord et par les ménages eux-mêmes, ce suivi les a conduits à prendre conscience de leurs croyances limitantes sur le confort. Ils ont par exemple pu se rendre compte qu’ils étaient, tour à tour, confortables à 17 °C à certains moments de la journée, et frigorifiés à 19 °C à d’autres moments, en fonction de l’heure, de leur état de forme, etc.
L’arrêt du chauffage réglé sur une température de consigne par défaut a ouvert de nouvelles perspectives de pilotage, en s’appuyant sur le ressenti plutôt que sur la température mesurée. Cela a pu aller, dans certains cas et pour certains ménages, jusqu’à l’arrêt complet du chauffage.
Ce détachement de la logique du chauffage central s’est opéré par palier, avec des retours en arrière en fonction de la météo, de l’état de santé… Bien entendu, il est d’autant plus facile dans un logement bien isolé et/ou ensoleillé, qui reste tempéré malgré l’absence de chauffage.
La combinaison de différents types de pratiques thermiques comme alternatives au chauffage a permis de ressentir du confort malgré une ambiance fraîche, avec des configurations variées en fonction des pièces.
L’adoption de tenues d’intérieur chaudes, en particulier, représentait un levier particulièrement efficace, qui a fait l’objet d’une recherche de personnalisation (charentaises versus crocs) par les participants en fonction de leur identité.
Ces pratiques thermiques recoupent un vaste répertoire hétéroclite de tactiques de compensation : ajouter un tapis, isoler une prise, faire du ménage ou du sport pour augmenter momentanément son métabolisme, accepter une sensation de froid passagère, utiliser ponctuellement un chauffage soufflant plutôt que le chauffage central, prendre une boisson chaude…
« Challenge douche froide » et transgression sociale
La consommation d’eau chaude est un thème qui a été spontanément abordé par certains des participants, même si la mise en œuvre des actions d’optimisation technique conseillées (par exemple, baisser la température du chauffe-eau) est restée rare. Plusieurs d’entre eux ont tout de même lancé un « challenge douche froide », ce qui a suscité un clivage dans le groupe, certains souhaitant rester à distance d’une pratique jugée radicale.
Ce clivage s’explique aussi par le fait que l’adoption de certaines pratiques de sobriété thermique puisse apparaître comme une transgression des normes sociales de confort en vigueur.
De fait, au sein des foyers, le bouleversement des habitudes nécessitait de tenir compte des sensibilités de chacun : conjoint suiveur ou récalcitrant, ado rebelle ou écolo, bébé et personne âgée dépendante. La difficile négociation avec les plus frileux passe par des compromis et par des exceptions. Cela a poussé certains participants à agir sans le dire, à imposer ou encore à renoncer.
Malgré le plan de sobriété en vigueur depuis 2023, certains des participants observaient un phénomène de surchauffage de certains locaux hors de chez eux : domiciles de leur entourage, lieux de travail, commerces, et tout particulièrement les lieux de santé et de la petite enfance. Ils déploraient alors le manque d’options : se découvrir, ou baisser discrètement le chauffage, ce qui n’était pas toujours possible.
Avec leurs invités en revanche, les ménages disposaient une capacité de prescription thermique. La proposition du designer d’organiser une soirée sans chauffage a été l’occasion d’expérimenter un nouvel art de recevoir : choisir des invités pas trop frileux, annoncer sans effrayer, réaménager le salon, proposer des accessoires comme le font certains cafetiers en terrasse (par exemple, plaids ou chaussons), des activités ou des dîners qui réchauffent (par exemple, une soirée raclette), etc.
La stigmatisation (« folle », « extrémiste ») subie par certains des participants de la part de leur entourage a parfois suscité une attitude de prudence, voire une dissimulation de leur participation à l’expérimentation (par exemple, relancer le chauffage quand les grands-parents viennent à la maison).
En revanche, les participants évoquaient plus volontiers leurs expériences thermiques dans le cadre de ce qu’on appelle les liens faibles : univers professionnel, voisinage élargi, cercles associatifs, etc.
Faut-il revoir nos normes de confort moderne ?
Depuis quelques années, les recherches convergent à commencer par celles des historiens, pour démontrer que les normes contemporaines du confort sont relatives. De multiples expérimentations sociotechniques en cours ouvrent le champ des possibles et pourraient bien contribuer à un nouveau départ en la matière.
Citons par exemple celle des pionniers belges de Slow Heat, de la designer Lucile Sauzet ou encore de l’architecte Martin Fessard. Notre expérimentation s’inscrit dans cette lignée et dessine les contours d’un nouvel idéal type de confort thermique, que nous proposons d’appeler : le confort sobre.
Il constitue une alternative au principe du chauffage central – chauffer (souvent uniformément) toutes les pièces d’un logement – composante essentielle du confort moderne, qui s’est démocratisé en France pendant les Trente Glorieuses (1945-1975). Le projet du confort sobre est de concilier les acquis de la modernité avec les exigences actuelles de la sobriété.
Jusqu’à présent, la sobriété thermique est trop souvent réduite à l’application d’une température de consigne. Mais, parler de confort sobre, c’est dépasser la pensée unique des 19 °C. Notre expérimentation a montré à quelles conditions les ménages pouvaient entrer dans une démarche de réexamen approfondi de leurs besoins en chauffage pour aboutir à une forme de détachement volontaire. Ce type de démarche pourrait servir de base à la mise en place d’une véritable politique de sobriété énergétique, volontaire plutôt que contrainte.
En effet, la stratégie actuelle de transition énergétique des logements repose encore trop souvent sur une forme de solutionnisme technologique. Pourtant, les participants à l’expérimentation sur le confort sobre ont souvent écarté les systèmes de pilotage intelligent pour leur préférer un pilotage manuel.
L’amélioration de la performance énergétique des logements reste bien sûr essentielle et peut faciliter l’adoption du confort sobre. Mais ce dernier interroge la pertinence d’un modèle de rénovation globale appliquée à l’aveugle à tous les logements.
Bien entendu, cette expérimentation reste, à ce stade, un pilote uniquement testé avec une quinzaine de familles. Mais l’ampleur des changements constatés chez ces ménages et leur volonté de prolonger l’expérience – voire de l’approfondir – cet hiver indiquent que la piste est intéressante. Les modalités de l’accompagnement à distance (visio, WhatsApp…) laissent à penser qu’un élargissement à grande échelle est possible, par le biais des fournisseurs d’énergie par exemple.
Gaëtan Brisepierre, Sociologue indépendant, École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.