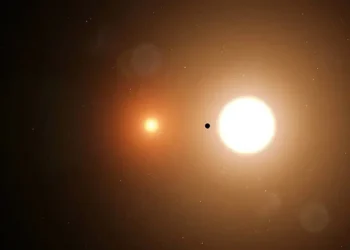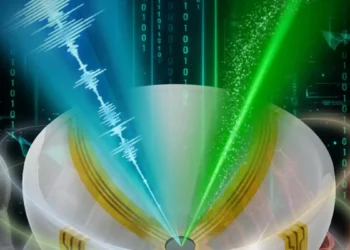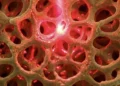Du fait de leurs propriétés et de leur faible coût, les plastiques se sont largement répandus, notamment dans les systèmes agricole et alimentaire depuis les années 1950. Dans ce contexte, les ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement ainsi que l’ADEME ont confié à INRAE et au CNRS le pilotage d’une expertise scientifique collective sur les plastiques utilisés en agriculture et pour l’alimentation, dont les résultats sont présentés le 23 mai lors d’un colloque public, permettant de faire un état des connaissances sur les usages, les propriétés et le recyclage des plastiques mais aussi sur leurs impacts sur l’environnement et la santé.
Selon les données existantes, 20 % des plastiques consommés en France seraient destinés aux secteurs agricole et alimentaire, en très grande majorité pour les emballages alimentaires. La composition et la structure des plastiques se sont complexifiées, notamment avec l’ajout d’additifs et de couches multiples, pour combiner plusieurs propriétés rendant ainsi leur recyclage plus difficile. Les résultats mettent aussi en lumière la contamination massive par les microplastiques de tous les sols, et en particulier les sols agricoles, dépassant probablement en tonnage celle des océans. Tous les organismes vivants sont contaminés par les microplastiques, y compris les humains, avec des effets néfastes pour la santé. Cette expertise met aussi en avant les besoins de recherche pour mieux intégrer les alternatives aux plastiques, pour simplifier les compositions et les structures, et pour mieux analyser les besoins des acteurs des secteurs agricole et alimentaire afin de réduire les plastiques à la source.
Cette expertise scientifique collective sur l’utilisation des plastiques[1] dans les systèmes agricole et alimentaire a mobilisé un comité de 30 experts français et européens qui ont travaillé sur un corpus de plus de 4 500 publications scientifiques internationales, tout en se référant aux chiffres et directives liés à la consommation des plastiques en Europe et en France. Les données sur les quantités de plastiques, de leur fabrication aux déchets, sont difficiles à consolider. Au niveau européen, ce sont en effet les acteurs du secteur privé des plastiques qui produisent les estimations et le manque de transparence méthodologique ainsi que la fragmentation des sources ne permettent pas, à ce jour, le suivi précis des flux de plastiques utilisés en agriculture et pour l’alimentation.
Cette expertise scientifique collective sur l’utilisation des plastiques[1] dans les systèmes agricole et alimentaire a mobilisé un comité de 30 experts français et européens qui ont travaillé sur un corpus de plus de 4 500 publications scientifiques internationales, tout en se référant aux chiffres et directives liés à la consommation des plastiques en Europe et en France. Les données sur les quantités de plastiques, de leur fabrication aux déchets, sont difficiles à consolider. Au niveau européen, ce sont en effet les acteurs du secteur privé des plastiques qui produisent les estimations et le manque de transparence méthodologique ainsi que la fragmentation des sources ne permettent pas, à ce jour, le suivi précis des flux de plastiques utilisés en agriculture et pour l’alimentation.
L’usage des plastiques a contribué à façonner la chaîne de valeur alimentaire contemporaine
Aujourd’hui, l’essentiel des usages des plastiques au sein des systèmes agricole et alimentaire se concentre sur les emballages alimentaires. Ainsi en France en 2023, 20 % des plastiques consommés seraient destinés aux secteurs agricole et alimentaire, dont 91 % servent à l’emballage des aliments et de boissons et 9 % à l’agriculture. Parmi les plastiques agricoles, 73 % sont utilisés dans les systèmes d’élevage.
Les plastiques sont utilisés pour protéger, préserver, transporter et promouvoir par le design et l’étiquetage les produits alimentaires. Ils visent à répondre à la fois aux contraintes réglementaires et aux besoins des acteurs économiques de la chaîne d’approvisionnement (légèreté, robustesse, faible coût, etc.). Dans les systèmes agricoles, la majorité des plastiques sont utilisés en élevage pour la conservation des fourrages, l’autre part concernant les cultures horticoles (paillages, tunnels de serre…). Ce sont les stratégies d’entreprises qui jouent un rôle-clé dans l’augmentation de l’utilisation des plastiques plutôt qu’une demande des consommateurs.
Portés par les efforts de marketing de l’industrie pétrochimique et par le contexte favorable de développement démographique et d’urbanisation dès les lendemains de la première guerre mondiale, les plastiques ont été largement adoptés dans le système alimentaire après la seconde guerre mondiale. Ils ont participé à construire les systèmes de distribution et de vente du XXe siècle, favorisant les circuits longs et les cultures sous serre. Leur utilisation, symbole de modernité, a transformé les modes de consommation, voire la nature même de certains aliments et ont ainsi modelé une culture du jetable.
Pourquoi la composition et la variété des plastiques sont-elles si complexes ?
Dans les domaines agricole et alimentaire, ce sont les propriétés mécaniques, radiométriques (capacité des plastiques à transmettre, réfléchir ou absorber le rayonnement solaire) et barrières aux gaz et aux liquides qui sont principalement étudiées. La volonté de combiner des propriétés, parfois incompatibles, aboutit à complexifier encore les formules avec l’ajout de différents additifs ou la production de multi-matériaux (matériaux multi-couches, alliages ou composites). C’est par exemple le cas des films agricoles qui ont été complexifiés pour résister aux contraintes environnementales dans la durée. Pourtant, les travaux montrent qu’il manque des essais sur le terrain, plutôt qu’en laboratoire, pour évaluer l’efficacité réelle des plastiques en conditions représentatives et ainsi mieux répondre aux besoins. Les plastiques biosourcés sont produits, en partie ou en totalité, à partir de biomasse (par exemple, l’acide polylactique – PLA – est obtenu à partir de maïs). Malgré le nombre croissant d’études scientifiques et de recherche et développement dans ce domaine, les plastiques biosourcés ne correspondent qu’à 1,5 % de la production française et européenne de plastiques en 2023. Leur formulation est tout aussi complexe et mobilise souvent l’ajout d’additifs ou de polymères pétrosourcés pour atteindre des propriétés similaires à d’autres plastiques pétrosourcés.
En plus des additifs ajoutés intentionnellement, les plastiques contiennent des substances résiduelles liées à leur fabrication ainsi que des contaminants, qui s’accumulent au contact de l’environnement durant leur cycle de vie, appelés NIAS (non-intentionnaly added substances, substances ajoutées de manière non intentionnelle). Ainsi, du fait également du secret industriel, la composition finale des plastiques reste souvent inconnue des utilisateurs.
Les modes de gestion et de recyclage des déchets plastiques
Si la majorité des plastiques sont recyclables, peu le sont dans les faits. À l’échelle mondiale, 64 % sont mis en décharge. À l’échelle européenne, 42 % des plastiques sont incinérés (33 % à l’échelle française) et 35 % sont envoyés au recyclage comme en France. Bien qu’ils influencent directement l’efficacité du recyclage, les modes de collecte et de tri des plastiques restent peu étudiés.
Le principal procédé de recyclage mis en œuvre à l’échelle industrielle est dit mécanique, procédé dans lequel la chaîne du polymère n’est pas modifiée. Mais il est contraint par la dégradation des matériaux, leur contamination et sa rentabilité limitée. Seul le recyclage des bouteilles d’eau en PET est destiné à produire le même objet sous une réglementation stricte. Le reste des plastiques alimentaires est recyclé pour fabriquer des produits différents car ils ne correspondent plus aux normes fixées par les règlementations des produits au contact de l’alimentation. En effet, le recyclage nécessite l’ajout d’additifs voire de nouveaux plastiques pour maintenir des propriétés fonctionnelles et est susceptible de véhiculer des contaminants. La complexité des plastiques rend le recyclage difficile et aucune technologie actuelle ne permet leur réutilisation complète.
Certains plastiques sont indiqués comme biodégradables, mais ils ne se décomposent que dans des conditions très spécifiques, voire uniquement en milieu industriel contrôlé. La majorité des plastiques pétrosourcés ne sont pas biodégradables, tout comme certains plastiques biosourcés. De plus, la présence de polymères pétrosourcés et d’additifs au sein d’un plastique « biosourcé » complique leur traitement. Les plastiques biodégradables restent faiblement biodégradés en conditions réelles (sols, compost domestique) et nécessitent un meilleur étiquetage pour adapter leur traitement selon leurs capacités réelles de biodégradation.
Les sols plus contaminés que les océans ?
Les plastiques utilisés dans l’agriculture et pour l’alimentation sont une source directe de contamination des écosystèmes. Tout au long de leur cycle de vie, leurs composants migrent dans l’environnement et ils se dégradent sous forme de particules : macro- (plus de 5 mm), micro- (de 1 µm à 5 mm) et nanoplastiques (moins de 1 µm).
Tous les types de sols, même désertiques, sont contaminés par des microplastiques à des taux allant de 100 à 10 000 particules de microplastiques par kg de sol dans le 1er mètre de profondeur. Les sols agricoles en particulier sont touchés. La contamination totale des sols par les microplastiques est vraisemblablement supérieure à la totalité de celle des océans. Les sources incluent les dispositifs plastiques agricoles comme le paillage, l’épandage de compost et de lisier, l’irrigation et les dépôts atmosphériques sans pouvoir quantifier, en l’état actuel des connaissances, la part exacte de chacune de ces contributions.
Les microplastiques servent d’habitat pour certains microorganismes qui réduisent la biodiversité microbienne du sol. Ils contaminent la flore et la faune directement via l’environnement ou par transfert le long de la chaîne alimentaire, contaminant d’abord les organismes du sol et les plantes.
Les effets de la contamination par les microplastiques sur la santé humaine et les écosystèmes
Chez les animaux et les humains, les microplastiques sont retrouvés dans la plupart des organes, comme les poumons, le système digestif, le placenta chez l’humain, et les fluides dont le lait maternel. Encore peu étudiés, les nanoplastiques peuvent pénétrer dans les cellules. Au niveau moléculaire, ils induisent un stress oxydatif et altèrent le métabolisme énergétique des cellules. Ces effets, rencontrés chez des organismes très éloignés, révèlent un danger des microplastiques pour l’ensemble des organismes des écosystèmes. Selon les études précliniques, les micro- et nanoplastiques induisent des pathologies du système reproducteur, des inflammations (côlon) et des fibroses (foie, rein, poumon, cœur). Ces dernières ont également permis d’établir des seuils de toxicité dès 20 µg/kg de masse corporelle et par jour pour plusieurs pathologies et organes cibles, et des effets neurologiques dès 6,5 ng/kg de masse corporelle et par jour. Ils impactent également la qualité de la production des animaux d’élevage (croissance, production de lait). De plus, en favorisant l’adsorption de nombreuses substances, les microplastiques agissent comme un « cheval de Troie » et véhiculent des contaminants toxiques comme des métaux ou des polluants chimiques.
En ce qui concerne les effets des substances contenues dans les plastiques sur la santé humaine, un grand nombre de constituants migrent depuis les plastiques en contact avec les aliments vers ces derniers. Parmi les plus de 10 000 substances potentiellement présentes dans les plastiques alimentaires, 2 familles ont concentré les efforts de recherche : les phtalates et le bisphénol A (BPA) qui sont réglementés au niveau européen. Ils sont reconnus comme perturbateurs endocriniens, et de nombreuses études démontrent leurs toxicités, même à faible dose, chez tous les organismes, en particulier sur les fonctions reproductives. Le BPA contribue au développement de maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 ou de l’obésité. Des maladies dont le coût a été estimé à plusieurs milliards de dollars en Europe. L’EFSA a signalé que l’exposition au BPA dépasse les seuils réglementaires pour la majorité de la population européenne.
Quel système durable pour l’usage des plastiques dans l’agriculture et l’alimentation ?
Le système des plastiques dans l’agriculture et l’alimentation ne peut être isolé du système global des plastiques, rendant complexes leur régulation et leur évaluation en matière de durabilité. Il n’existe pas de réglementation spécifique aux plastiques qui dépendent de 3 cadres juridiques européens : les matériaux au contact des aliments, les produits chimiques et la gestion des déchets. À cela s’ajoutent des variations du champ d’application des plastiques d’un régime juridique à un autre. L’analyse du cycle de vie est le principal outil utilisé pour évaluer la durabilité des plastiques. Mais ces méthodes sont incomplètes et ne s’intéressent généralement pas à tous les impacts environnementaux, hormis les émissions de gaz à effet de serre ou la diminution des ressources non renouvelables.
La nécessité d’une réduction de la production de plastiques est un constat partagé par la communauté scientifique. Les stratégies de gestion des plastiques ont jusqu’à présent priorisé le recyclage, une action curative plus que préventive qui nécessite, en l’état actuel des connaissances, d’introduire des plastiques vierges dans le processus. La priorité donnée au recyclage peut détourner, par exemple, des stratégies de réemploi et renforcer l’idée que consommer du plastique reste acceptable, freinant des changements culturels profonds, notamment dans les manières de s’alimenter. L’augmentation de déchets plastiques, même mieux collectés ou triés, s’accompagne d’une augmentation de déchets mal gérés. Les alternatives aux plastiques étudiées, bien que biosourcées, demeurent des plastiques et la complexité de leur recette de fabrication et de leur traitement reste identique. Même si les moyens concrets de leur mise en œuvre sont limités, les stratégies de réduction mentionnent l’éducation à l’environnement, le contrôle de la pratique du lobbying et des politiques de régulation qui sont en vigueur, comme la directive sur les plastiques à usage unique ou la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et en devenir, comme les négociations sur un traité mondial pour lutter contre les pollutions plastiques. Un axe de recherche scientifique important sera désormais de documenter précisément les usages réputés essentiels des plastiques tout au long de la chaîne de valeur, pour identifier des scénarios réalistes de réduction de leur production et de leur consommation.
Notes :
- Les plastiques sont composés en moyenne de 93 % de polymères (des composés formés par des répétitions d’unités à base de carbone – appelées monomères – qui sont reliées les unes aux autres pour former une structure en forme de chaîne) combinés à 7 % d’additifs, toutes applications confondues avec de grandes variations en termes de composition. Plus de 10 000 composants, ajoutés volontairement ou non aux polymères, peuvent être présents. Les 5 polymères les plus utilisés dans le monde en agriculture et pour l’alimentation sont le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polyéthylène téréphtalate (PET), le polystyrène (PS) et le polychlorure de vinyle (PVC).
Source : INRAE-CNRS
Fiche Synthèse
Pourquoi lire cet article ?
- Public cible : journalistes scientifiques, responsables politiques, acheteurs de la grande distribution, coopératives agricoles, startups de l’AgTech, ONG environnementales.
- Problème traité : comprendre l’ampleur de l’usage des plastiques dans la chaîne agro-alimentaire, ses impacts sanitaires-environnementaux et les leviers concrets de réduction.
- Questions clés auxquelles nous répondons :
- « Quels plastiques retrouve-t-on le plus dans les emballages alimentaires ? »
- « Les microplastiques menacent-ils plus les sols que les océans ? »
- « Comment réduire l’empreinte plastique sans sacrifier la sécurité alimentaire ? »
1. Chiffres clés à connaître
- 20% des plastiques consommés en France servent aux secteurs agricole et alimentaire (2023).
- 91% de ces volumes finissent dans les emballages ; 9% dans les applications agricoles.
- Les plastiques agricoles sont utilisés à 73% en élevage (ensilage, filets, bâches), le reste en culture sous serre, paillage, irrigation.
- Seuls 35% des plastiques sont effectivement recyclés en France ; la majorité termine en incinération ou décharge.
- Les sols agricoles contiennent jusqu’à 10 000 particules microplastiques/kg, un fardeau probablement supérieur à celui des océans.
2. Comment les plastiques ont façonné la chaîne de valeur alimentaire
- Après 1950 : marketing pétrochimique + boom démographique => adoption massive dans la distribution longue distance (barquettes, films, bouteilles PET).
- Fonctions recherchées : légèreté, barrière à l’oxygène, maniabilité pour la logistique du froid, design marketing.
- Résultat ? Une culture du jetable qui alimente le volume de déchets et complexifie le recyclage, car les emballages combinent multi-couches + additifs + encres.
3. Complexité des formulations plastiques : pourquoi c’est un casse-tête
| Propriété visée | Additifs fréquents | Conséquence sur le recyclage |
|---|---|---|
| Barrière gaz/UV | EVOH, absorbeurs UV | Séparation coûteuse, qualité du recyclat dégradée |
| Résistance mécanique | Carbonate de Ca, fibres | Contamination des filières mécaniques |
| Transparence & brillance | Plastifiants, phtalates | Migration vers l’aliment & santé publique |
- Polymères dominants : PE, PP, PET, PS, PVC.
- Plastiques biosourcés : 1,5% de la production ; nécessitent souvent des polymères fossiles pour atteindre les mêmes performances → faux remède sans écoconception globale.
4. Micro- et nanoplastiques : un risque sanitaire documenté
- Détectés dans poumons, placenta, lait maternel, sols, eaux.
- Seuils de toxicité identifiés dès 20 µg/kg/j pour plusieurs organes chez l’animal.
- Agissent comme « cheval de Troie » transportant métaux lourds & perturbateurs endocriniens (phtalates, BPA).
- Effets constatés : inflammation intestinale, fibrose hépatique, troubles reproducteurs, baisse de croissance en élevage.
5. Trois leviers d’action concrets pour réduire la pollution plastique
- Écoconception & substitution ciblée
- Simplifier les mono-matériaux ; privilégier PE ou PP vierge à haut taux de recyclage.
- Remplacer les sachets multicouches par du papier-barrière compostable certifié DIN-EN 13432.
- Réemploi & vrac
- Consigne en verre ou inox pour laiterie, bière, sauces.
- Distributeurs automatiques en magasins pour céréales/pâtes : réduit jusqu’à 70% le volume d’emballages sur un an selon l’ADEME.
- Collecte-tri intelligent & traçabilité
- RFID ou QR-codes pour identifier les formulations et orienter vers la bonne filière.
- Modulation éco-contribution : plus la structure est complexe, plus le producteur paye.
6. Cadre réglementaire et pistes de gouvernance
- Trois piliers UE : matériaux au contact des aliments, règlement REACH (chimie), directives déchets.
- Lacune majeure : pas de texte unique couvrant l’empreinte plastique de l’amont agricole à l’assiette.
- Tendances 2025-2030 : traité mondial anti-pollution plastique, quotas de contenu recyclé, taxes sur polymères vierges.
- Bonnes pratiques entreprise : reporting Scope 3 plastique, audit de flux matière, certification ISO 14006 (écoconception).
7. Foire aux questions express (FAQ)
Q : Quels sont les plastiques réellement biodégradables en sol ?
R : Seuls certains PLA/PHAs se dégradent en compost industriel contrôlé ; la biodégradation en sol ouvert reste inférieure à 20% en 12 mois.
Q : Pourquoi le recyclage chimique n’est-il pas la panacée ?
R : Haut coût énergétique, émissions CO₂ et potentiel relargage de contaminants ; aujourd’hui limité au PET bouteille-à-bouteille.
Q : Le BPA est-il encore autorisé ?
R : Limites drastiquement abaissées par l’EFSA ; l’exposition de la population européenne dépasse toujours les seuils tolérables.
8. Points d’action pour chaque acteur
| Acteur | Action prioritaire | Bénéfice rapide |
|---|---|---|
| Journalistes | Utiliser ces données pour enquêter sur les filières locales | Sensibilisation du public, pression réglementaire |
| Industriels agro | Passer à des emballages mono-PE recyclables | Réduction éco-contribution + image marque |
| Agriculteurs | Tester les films de paillage compostables | Moins de résidus plastiques, label agroécologie |
| Décideurs publics | Fixer des objectifs chiffrés de réduction (-40% d’ici 2030) | Alignement avec pacte vert européen |
| Chercheurs | Quantifier le flux microplastiques sol→plante→aliment | Base scientifique pour normes futures |
Conclusion
Réduire, simplifier, réemployer : voilà le triptyque indispensable pour sortir d’une logique curative centrée sur le seul recyclage. Les preuves s’accumulent : les sols sont déjà plus contaminés que les océans, et les impacts sanitaires ne sont plus discutables. L’heure n’est plus à la simple optimisation des filières existantes mais à une refonte stratégique des usages jugés réellement essentiels.