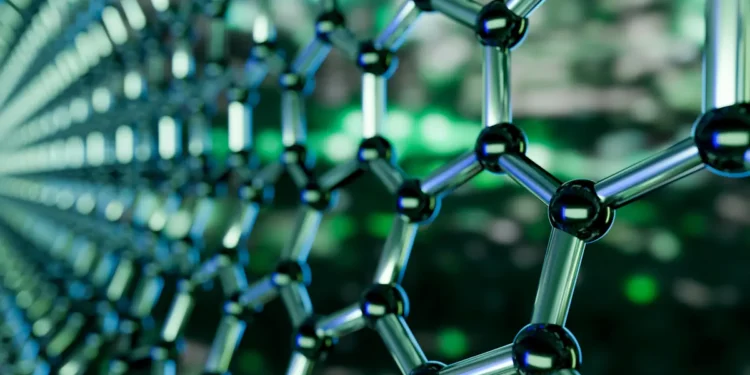Le graphite est un composant structurel essentiel dans certains des réacteurs nucléaires les plus anciens au monde et dans de nombreux modèles de nouvelle génération actuellement en cours de construction. Cependant, il se condense et gonfle sous l’effet des rayonnements, et le mécanisme à l’origine de ces changements s’est avéré difficile à étudier.
Aujourd’hui, des chercheurs du MIT et leurs collaborateurs ont découvert un lien entre les propriétés du graphite et le comportement du matériau en réponse aux rayonnements. Ces résultats pourraient déboucher sur des méthodes plus précises et moins destructrices pour prédire la durée de vie des matériaux en graphite utilisés dans les réacteurs du monde entier.
« Nous avons mené des recherches fondamentales pour comprendre ce qui provoque le gonflement et, à terme, la défaillance des structures en graphite », indique Boris Khaykovich, chercheur au MIT et auteur principal de la nouvelle étude. « Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour mettre cela en pratique, mais l’article propose une idée intéressante pour l’industrie : il ne serait peut-être pas nécessaire de casser des centaines d’échantillons irradiés pour comprendre leur point de rupture. »
Plus précisément, l’étude montre un lien entre la taille des pores du graphite et la façon dont le matériau gonfle et rétrécit en volume, ce qui entraîne sa dégradation.
« La durée de vie du graphite nucléaire est limitée par le gonflement induit par l’irradiation », explique Lance Snead, coauteur et chercheur au MIT. « La porosité est un facteur déterminant dans ce gonflement, et bien que le graphite ait fait l’objet d’études approfondies pour des applications nucléaires depuis le projet Manhattan, nous ne comprenons toujours pas clairement la porosité dans les propriétés mécaniques et le gonflement. Ce travail aborde cette question. »
Un matériau complexe étudié depuis longtemps
Depuis 1942, date à laquelle des physiciens et des ingénieurs ont construit le premier réacteur nucléaire au monde dans un ancien court de squash de l’université de Chicago, le graphite joue un rôle central dans la production d’énergie nucléaire. Ce premier réacteur, baptisé Chicago Pile, était constitué d’environ 40 000 blocs de graphite, dont beaucoup contenaient des pépites d’uranium.
Aujourd’hui, le graphite est un composant essentiel de nombreux réacteurs nucléaires en service et devrait jouer un rôle central dans la conception des réacteurs de nouvelle génération, tels que les réacteurs à sels fondus et les réacteurs à gaz à haute température. En effet, le graphite est un bon modérateur de neutrons, ralentissant les neutrons libérés par la fission nucléaire afin qu’ils soient plus susceptibles de créer eux-mêmes des fissions et de maintenir une réaction en chaîne.
« La simplicité du graphite le rend précieux », ajoute M. Khaykovich. « Il est composé de carbone et on sait relativement bien comment le produire de manière propre. Le graphite est une technologie très mature. Il est simple, stable et nous savons qu’il fonctionne. »
Mais le graphite présente également des complexités.
« Nous appelons le graphite un composite, même s’il est composé uniquement d’atomes de carbone », précise M. Khaykovich. « Il comprend des « particules de remplissage » qui sont plus cristallines, puis une matrice appelée « liant » qui est moins cristalline, et enfin des pores dont la longueur varie de quelques nanomètres à plusieurs microns. »
Chaque grade de graphite a sa propre structure composite, mais tous contiennent des fractales, c’est-à-dire des formes qui semblent identiques à différentes échelles.
Ces complexités ont rendu difficile la prédiction de la manière dont le graphite réagira aux rayonnements à l’échelle microscopique, même si l’on sait depuis des décennies que lorsqu’il est irradié, le graphite se densifie d’abord, réduisant son volume jusqu’à 10 %, avant de gonfler et de se fissurer. La fluctuation de volume est causée par des changements dans la porosité et la contrainte du réseau cristallin du graphite.
« Le graphite se détériore sous l’effet des rayonnements, comme tout autre matériau », indique M. Khaykovich. « Ainsi, d’un côté, nous avons un matériau extrêmement bien connu, et de l’autre, un matériau extrêmement complexe, dont le comportement est impossible à prédire par des simulations informatiques. »
Pour cette étude, les chercheurs ont reçu des échantillons de graphite irradié provenant du laboratoire national d’Oak Ridge. Les coauteurs Campbell et Snead ont participé à l’irradiation de ces échantillons il y a environ 20 ans. Les échantillons sont d’un type de graphite appelé G347A.
L’équipe de recherche a utilisé une technique d’analyse appelée diffusion des rayons X, qui utilise l’intensité diffusée d’un faisceau de rayons X pour analyser les propriétés d’un matériau. Plus précisément, ils ont examiné la distribution des tailles et des surfaces des pores de l’échantillon, ou ce que l’on appelle les dimensions fractales du matériau.
« Lorsque vous observez l’intensité de diffusion, vous constatez une grande variabilité de la porosité », dit Sean Fayfar. « Le graphite présente une porosité à très grande échelle, et vous obtenez cette auto-similarité fractale : les pores de très petite taille ressemblent à des pores de plusieurs microns, nous avons donc utilisé des modèles fractals pour relier différentes morphologies à travers les échelles de longueur. »
Les modèles fractals avaient déjà été utilisés sur des échantillons de graphite, mais jamais sur des échantillons irradiés afin d’observer comment la structure poreuse du matériau évoluait. Les chercheurs ont découvert que lorsque le graphite est exposé pour la première fois à des rayonnements, ses pores se remplissent à mesure que le matériau se dégrade.
« Mais ce qui nous a vraiment surpris, c’est que la distribution de la taille des pores s’est inversée », ajoute M. Fayfar. « Nous avons observé un processus de récupération qui correspondait à nos graphiques de volume global, ce qui était assez étrange. Il semble qu’après avoir été irradié pendant un certain temps, le graphite commence à se régénérer. Il s’agit en quelque sorte d’un processus de recuit au cours duquel de nouveaux pores se forment, puis se lissent et s’agrandissent légèrement. Cela a été une grande surprise. »
Les chercheurs ont découvert que la distribution de la taille des pores suit de près le changement de volume causé par les dommages dus aux rayonnements.
« La découverte d’une forte corrélation entre la [distribution de la taille des pores] et les changements de volume du graphite est une nouvelle découverte, qui permet de faire le lien avec la défaillance du matériau sous irradiation », explique M. Khaykovich. « Il est important que les gens sachent comment les pièces en graphite vont se dégrader lorsqu’elles sont soumises à des contraintes et comment la probabilité de défaillance change sous irradiation. »
De la recherche aux réacteurs
Les chercheurs prévoient d’étudier d’autres qualités de graphite et d’explorer plus en détail la corrélation entre la taille des pores dans le graphite irradié et la probabilité de défaillance. Ils émettent l’hypothèse qu’une technique statistique connue sous le nom de distribution de Weibull pourrait être utilisée pour prédire le temps de défaillance du graphite. La distribution de Weibull est déjà utilisée pour décrire la probabilité de défaillance des céramiques et d’autres matériaux poreux tels que les alliages métalliques.
Khaykovich a également émis l’hypothèse que ces résultats pourraient contribuer à notre compréhension des raisons pour lesquelles les matériaux se densifient et gonflent sous l’effet des rayonnements.
« Il n’existe aucun modèle quantitatif de densification qui tienne compte de ce qui se passe à ces échelles minuscules dans le graphite », indique Khaykovich. « La densification du graphite sous l’effet des rayonnements me fait penser au sable ou au sucre, où lorsque vous écrasez de gros morceaux en grains plus petits, ils se densifient. Dans le cas du graphite nucléaire, la force de broyage est l’énergie apportée par les neutrons, qui provoque le remplissage des grands pores par des morceaux plus petits et broyés. Mais plus d’énergie et d’agitation créent encore plus de pores, et le graphite gonfle à nouveau. Ce n’est pas une analogie parfaite, mais je pense que les analogies permettent de mieux comprendre ces matériaux. »
Les chercheurs décrivent cet article comme une étape importante pour informer sur la production et l’utilisation du graphite dans les réacteurs nucléaires du futur.
« Le graphite est étudié depuis très longtemps, et nous avons développé de nombreuses intuitions solides sur la façon dont il réagira dans différents environnements, mais lorsque vous construisez un réacteur nucléaire, les détails comptent », conclut M. Khaykovich. « Les gens veulent des chiffres. Ils ont besoin de savoir dans quelle mesure la conductivité thermique va changer, dans quelle mesure il y aura des fissures et des changements de volume. Si les composants changent de volume, à un moment donné, vous devez en tenir compte. »
L’article en libre accès est publié cette semaine dans Interdisciplinary Materials. Il est co-écrit par Khaykovich, Snead, Sean Fayfar, chercheur au MIT, Durgesh Rai, ancien chercheur au MIT, David Sprouster, professeur adjoint à l’université Stony Brook, Anne Campbell, scientifique au laboratoire national d’Oak Ridge, et Jan Ilavsky, physicien au laboratoire national d’Argonne.
Article : « Linking Lattice Strain and Fractal Dimensions to Non-monotonic Volume Changes in Irradiated Nuclear Graphite » – DOI : 10.1002/idm2.70008