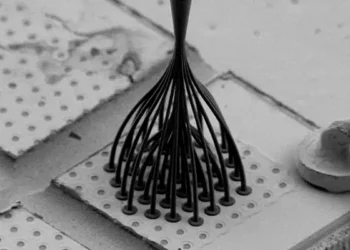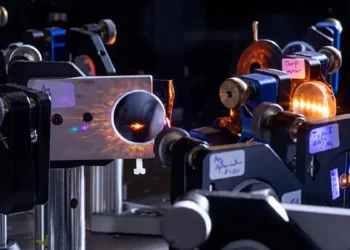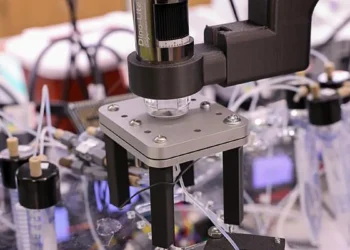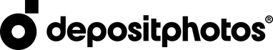Il est facile d’oublier que le cloud n’est pas une boule de duvet amorphe, explique la professeure de l’UC Berkeley Alex Saum-Pascual — qu’il s’agit en réalité d’une infrastructure internet physique qui prend de nombreuses formes en de nombreux endroits du monde.
Dans son prochain livre, Earthly Algorithms: A Materialist Reading of Digital Literature , Saum-Pascual soutient que les outils numériques comme l’IA générative masquent la réalité désordonnée d’internet — l’énergie massive, le matériel et la main-d’œuvre humaine qu’il exige — pour nous tromper en nous faisant croire que nous sommes séparés de la nature.
Cette empreinte massive s’étend à tous les coins du globe. Des centaines de câbles à fibres optiques, enterrés sous terre et croisant les fonds marins, se connectent à des millions de serveurs hébergés dans des centres de données anonymes situés de la Californie et la Floride à l’Irlande et l’Indonésie. Avec eux viennent des coûts environnementaux et sociaux significatifs, qu’il s’agisse d’émissions de carbone en hausse, de pénuries d’eau locales, de fragmentation des habitats ou de déplacement des communautés.
« Je me suis toujours intéressée à cet exercice de visibilité, car il y a quelque chose de si pervers dans la technologie numérique », déclare Saum-Pascual, professeure associée de littérature et culture espagnoles contemporaines et des nouveaux médias. « N’est-il pas surprenant que la plus grande chose que les humains aient créée — internet — soit la plus cachée ? »
Dans cette interview de UC Berkeley News , Saum-Pascual explique comment elle vise à ramener la réalité d’internet à la surface, et pourquoi nous devrions traiter l’IA comme un « pharmakon — une sorte de médicament dont un peu peut vous guérir et trop peut vous tuer. »
UC Berkeley News : Il est facile pour beaucoup d’entre nous de négliger l’énorme quantité d’énergie qu’internet exige pour fonctionner en continu. Lorsque nous faisons une interview Zoom ou regardons un film en streaming, cela utilise des ressources importantes. Pourquoi pensez-vous qu’il est important de s’attaquer à la matérialité d’internet ?
Alex Saum-Pascual : Il est si vrai que nous oublions ou ne savons pas tout ce qui entre en jeu pour faire fonctionner internet et les technologies sans fil. Pour cette interview, je pense que je vous parle, n’est-ce pas ? Et c’est le cas, mais je parle aussi dans ce micro et puis tous ces écrans fabriqués par toutes ces entreprises. Je ne sais pas non plus où la plateforme d’enregistrement stocke ces données. Nous ne savons pas. Il y a beaucoup d’opacité là-dedans.
« N’est-il pas surprenant que la plus grande chose que les humains aient créée — internet — soit la plus cachée ? »
Et cela importe parce que différentes entreprises et leurs centres de données sont situés dans différentes parties du monde qui ont des politiques différentes, qui ont des approches différentes de la durabilité, du travail — et toutes ces choses semblent s’estomper en arrière-plan. Nous ne savons pas ou ne voulons pas savoir.
Dans la technologie numérique, nous avons cet objet qui est virtuel — et nous utilisons ce mot « virtuel », qui pointe vers l’immatérialité, voire l’éphémère. Et la partie logicielle est douce — c’est comme un nuage. Cela semble inoffensif.
Mais ensuite, nous avons les systèmes matériels massifs ou les infrastructures qui nécessitent de l’espace et des ressources et des changements dans les politiques locales, et elles déplacent les gens d’un endroit à un autre, elles utilisent leurs ressources énergétiques, elles produisent des émissions. Et il semble que la prolifération de ces technologies nécessite leur invisibilisation, de cette infrastructure terrestre massive, pour que nous continuions à interagir avec elles.
Comment l’explosion récente de l’intelligence artificielle et ses besoins croissants en données contribuent-elles à cet accaparement des ressources naturelles et humaines ?
L’impact environnemental de la technologie numérique a toujours été là. Il a toujours été mauvais. Et les gens n’y pensent généralement pas. Je pense que c’est devenu un peu plus courant au cours des dernières années, peut-être, je suppose, grâce à la grande poussée des ressources de la génération d’IA.
L’intelligence artificielle nécessite une énorme quantité d’énergie pour fonctionner et être développée comme nous le faisons actuellement. Et elle nécessitera une poussée encore plus grande à l’avenir, car à mesure que les modèles deviennent plus sophistiqués, ils seront déployés dans de plus en plus de domaines de notre vie. C’est donc ce genre de paradoxe pervers de Jevons, qui parle du fait que lorsqu’une chose devient plus efficace, la demande pour elle augmente et avec cette augmentation de la demande vient une demande pour plus de ressources, donc à la fin elles s’annulent mutuellement.
D’une certaine manière, cette prise de conscience croissante autour de l’IA générative cache en quelque sorte l’impact environnemental des autres technologies que nous utilisons tout le temps.
Comme quoi ?
Le streaming nécessite que des centres de données massifs soient allumés en permanence rien que pour que vous puissiez regarder n’importe quelle émission, et c’est très polluant. Ou les milliers d’e-mails non lus que vous avez dans votre boîte de réception, ils sont stockés quelque part. Peut-être devriez-vous simplement les supprimer. Ou la poussée pour que les gens aient des téléviseurs de plus en plus grands dans leur maison qui nécessitent la 4K. Cela nécessite plus de données, plus de consommation.
Nous ne pensons jamais à ces choses parce qu’elles sont si courantes. Quand quelque chose devient automatique, il devient invisible — nous cessons de le remarquer. Cela devient une caractéristique si commune de nos vies que nous n’y prêtons plus attention.
Comment les arts et les humanités pourraient-ils nous aider à voir l’impact de ces technologies numériques alors qu’elles sont déjà si étroitement tissées dans notre vie quotidienne ?
Dans son essai de 1917 « L’art comme procédé », le critique formaliste russe Viktor Chklovski a proposé que le but de l’art soit la défamiliarisation, que l’étrangeté du quotidien pourrait permettre de le voir à nouveau. Cela donne une sorte de composante éthique et même activiste aux rôles de la littérature et des arts — qu’en rendant les choses étranges, elles peuvent redevenir perceptibles.
Mais je trouve cet argument de moins en moins convaincant, parce que nous savons. Nous savons beaucoup de choses que nous faisons, nous savons qu’elles sont mauvaises. Je veux dire, je viens de vous dire que le streaming était terrible, mais je vais probablement aller regarder une émission ce soir. Il y a cette terrible possibilité que comprendre quelque chose ne conduise pas à un changement de comportement. C’est un problème pour moi.
Que pensez-vous qui pourrait sortir les gens de cette connaissance qu’une chose est nocive et qu’ils la font quand même pour changer leur comportement, même un peu ?
Peut-être devons-nous examiner différentes façons de savoir quelque chose, même si elles ne sont pas comprises intellectuellement ou qu’elles ne sont pas capturées par les modes de représentation actuels dont nous disposons. C’est une question que j’explore, à la fois dans ma propre pratique créative et avec mes étudiants à Berkeley.
Comment cela ?
J’ai récemment publié un poème numérique, « Résistance à » — il a été commandé par le Los Angeles Review , et ils m’ont demandé de réfléchir au concept de joie ou de résistance par la joie.
J’ai essayé de m’éloigner de la génération automatique parce que puisque tout le monde écrit avec des bots maintenant, je pense que le défi n’est pas de faire sonner le bot plus humain, mais que les humains sonnent moins comme des bots. Et je voulais apporter un objet numérique qui présente très clairement mon intervention, mon corps, ma présence.
« Puisque tout le monde écrit avec des bots maintenant, le défi n’est pas de faire sonner le bot plus humain, mais que les humains sonnent moins comme des bots. »
Le poème commence sur le site web, et vous pouvez lire la première partie, mais cela nécessite un téléchargement vers votre propre ordinateur personnel pour montrer ce voyage de l’information entre le site web et votre ordinateur pour mettre en lumière cette infrastructure. Et je cartographie la distance entre mon ordinateur à la maison et le serveur où se trouve ce site web, et je cartographie un voyage possible. Et cela m’a fait réfléchir non seulement à la matérialité de l’objet, mais aussi à mon propre voyage en tant que corps immigré aux États-Unis.
Ainsi, toute personne qui expérimente cette œuvre doit fournir un certain travail. Elle doit cliquer, puis charger, puis zipper et ouvrir, et ensuite cela ouvre un site web interactif. Vous devez naviguer à travers les différents écrans et trouver les hyperliens ou les hyperliens cachés. En faisant cela, ils voient que l’œuvre elle-même bouge — elle est copiée, elle occupe de l’espace, elle utilise des ressources.
Et j’ai commencé à apprendre à mes étudiants à regarder une œuvre et à dire : « Comment cela a-t-il été fait ? Voyons si nous pourrions le faire », et à s’engager dans cette pratique plus concrète autour du travail numérique et du littéraire.
Vous enseignez un cours où vos étudiants créent des œuvres de littérature électronique — des pièces qui dépendent des technologies numériques pour exister. Quels types de pièces créent-ils et qu’espérez-vous qu’ils retirent de cette expérience ?
Dans ce cours, nous examinons différents modes de littérature électronique. Ils pourraient expérimenter avec des narratives géolocalisées qui changent selon l’emplacement physique du lecteur ou avec la création de poésie algorithmique générée par du code en temps réel. J’invite également les étudiants à créer des bots. En fin de compte, le but est que les étudiants réalisent que ce n’est pas vraiment la compétence technique qui va les rendre réussis dans ce cours, mais l’usage critique de ces technologies avec la bonne intention poétique ou narrative.
Comment pensez-vous à l’enseignement de vos autres cours de littérature et d’études culturelles qui n’interfacent pas directement avec les technologies numériques ? Avez-vous une politique d’IA dans ces cours ?
C’est difficile parce que je suis devenue en quelque sorte la personne IA et pourtant je suis toujours dans mes cours à dire : « Ne l’utilisez pas, ne l’utilisez pas. »
Mais ce n’est pas exactement cela. Je dirais, comme pour tout, utilisez-la en comprenant que vous participez avec quelque chose qui a cette histoire, qui a ces origines, qui crée et a cet impact dans le monde. Tout comme quand je décide de manger un burger : je sais que c’est insoutenable, alors peut-être que j’essaie de manger moins de viande, disons.
La chose que je pense importante est d’être très intentionnel dans nos usages de l’IA générative et, en particulier, des produits plus commerciaux que nous utilisons. Comme Berkeley s’associe avec Google, et donc nous utilisons Gemini. Et chaque fois que j’ouvre la plateforme, on m’invite à utiliser une sorte de génération d’images, et je me dis : « Non, je n’en ai pas besoin. » Mais il pourrait y avoir un cas où vous pourriez vraiment bénéficier de cette utilisation. Alors utilisez-la avec légèreté.
J’aime l’idée que la technologie numérique soit un peu comme un pharmakon : une sorte de médicament dont un peu peut vous guérir et trop peut vous tuer.