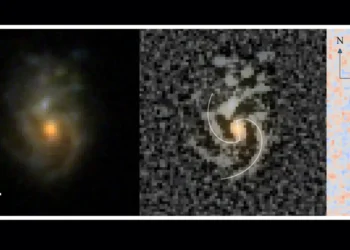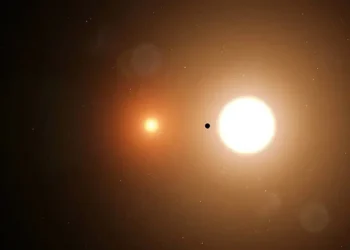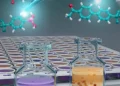Le brasier qui consume depuis mardi soir le massif des Corbières, dans l’Aude, progresse à une vitesse que les pompiers jugent « hors norme ». Mercredi, le bilan officiel de la préfecture faisait état de plus de 16 000 ha partis en fumée, quinze communes touchées et une topographie calcinée sur une vingtaine de kilomètres. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a réuni dès l’aube la cellule ministérielle de veille opérationnelle et d’alerte : l’heure n’est plus à l’anticipation, mais à la gestion d’une crise d’ampleur nationale.
Un feu inédit depuis un demi-siècle
Seul le mégafeu de 2022, lui aussi surnommé « monstre » par les forestiers, avait dépassé la barre des 10 000 ha depuis 1976. L’incendie actuel engloutit, à lui seul, l’équivalent des surfaces brûlées en 2019, 2020, 2021 et 2024 réunies, et le double de 2023. Les chiffres donnent le vertige : une victime décédée, une personne portée disparue, treize blessés dont sept soldats du feu, 25 maisons endommagées, des dizaines de voitures réduites à l’état de carcasses. L’A9 a été coupée dans la nuit, et 2 500 foyers ont été plongés dans le noir après la mise hors tension préventive de deux lignes à haute tension.
Mardi, la tramontane a soufflé en rafales jusqu’à 60 km/h, sous 30 °C et avec un taux d’humidité proche du plancher : un cocktail explosif. Les services de Météo-France avaient, dès l’après-midi, hissé l’Aude au niveau de vigilance rouge « feux de forêt », unique département à atteindre ce seuil. À cette heure, l’origine du feu reste inconnue, mais les enquêteurs privilégient déjà la piste humaine, responsable de neuf départs sur dix, rappellent inlassablement les autorités.
Quand la sécheresse attise les flammes
Placée en situation de crise sécheresse le 1ᵉʳ août, l’Aude n’avait plus enregistré de pluie significative depuis plusieurs semaines. Au sud, les Pyrénées-Orientales subissent, elles, une diminution de 60% des précipitations depuis 2022 : le déficit hydrique régional transforme la garrigue en poudre. Mercredi, 32 départements français restaient classés en crise sécheresse, 14 en alerte renforcée, 27 en alerte simple et 18 en vigilance.
Le centre opérationnel départemental a été déclenché. Sur le terrain, plus de 1 000 sapeurs-pompiers, appuyés par huit avions bombardiers d’eau et trois hélicoptères, s’emploient à contenir les lisières les plus menaçantes. L’Office national des forêts, fort de 100 patrouilles déployées sur l’arc méditerranéen, traque la moindre reprise de flamme. La préfecture a ouvert une cellule d’information au public, tandis que la campagne nationale de prévention, portée par le ministère, martèle ses messages sur les ondes régionales.
Un risque persistant jusqu’au week-end
Les prévisionnistes redoutent un nouvel épisode venteux samedi, susceptible de ranimer des foyers latents. La Gironde et le massif des Landes de Gascogne, restés jusqu’ici relativement épargnés, sont placés sous étroite surveillance. Les autorités invitent la population à reporter toute activité en forêt et à signaler immédiatement les fumées suspectes.
Agnès Pannier-Runacher n’a pas mâché ses mots : « Ce drame humain est le visage concret du dérèglement climatique. », a-t-elle déclaré, rappelant la Stratégie nationale de défense des forêts contre l’incendie et le nouveau programme de cartographie des risques. Pour la ministre, « au-delà des moyens pour faire face à l’urgence, c’est la prévention et l’anticipation seront nos meilleurs boucliers. ».
Sur place mercredi, le chef du gouvernement a rencontré les sinistrés et les équipes de secours. Son déplacement vise autant à soutenir les équipes qu’à esquisser les futures mesures de reconstruction. Les communes touchées réclament déjà la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle afin de débloquer les indemnisations.
Source : Ecologie.gouv / Préfecture Aude