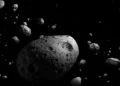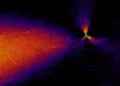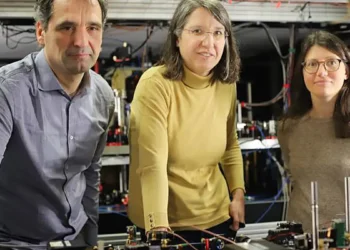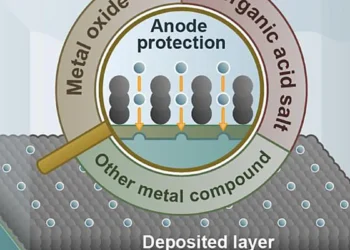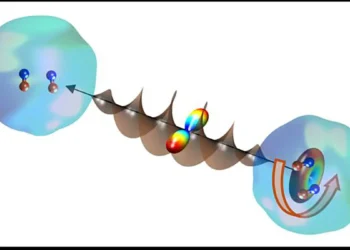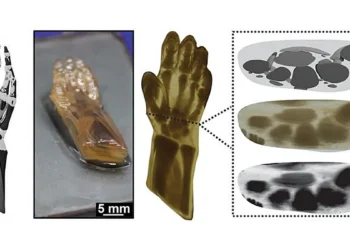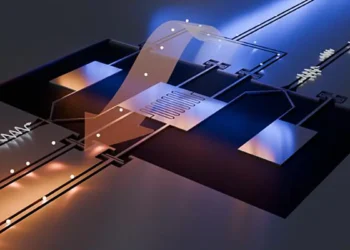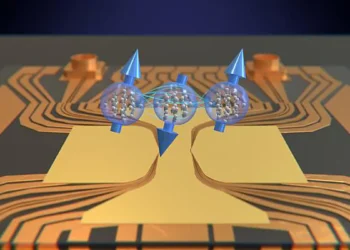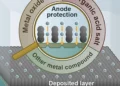L’objet interstellaire 3I/ATLAS, qui traverse actuellement l’espace entre les orbites de Mars et de la Terre en ce mois d’octobre 2025, constitue un phénomène astronomique rare qui attise la curiosité scientifique. Dans un billet quasi-quotidien, l’astrophysicien Avi Loeb, actuel directeur du « Galileo Project », s’est penché sur les caractéristiques gravitationnelles particulières de cet astre vagabond. Ses calculs révèlent un paradoxe. En effet selon lui, malgré une masse colossale dépassant 33 milliards de tonnes, 3I/ATLAS possède une attraction gravitationnelle étonnamment modeste, bien loin de celle qui nous retient sur Terre.
Une gravité mesurée à l’aune de la vitesse de libération
Pour évaluer la profondeur d’un puits gravitationnel, les scientifiques s’intéressent généralement à la vitesse nécessaire pour s’en échapper. Dans son analyse, Avi Loeb établit une échelle de comparaison : « La vitesse de libération de la Lune est de 2,4 kilomètres par seconde, environ deux fois la vitesse d’une balle de fusil », tandis qu’un trou noir impose une vitesse supérieure à celle de la lumière, transformant ces objets en véritables prisons gravitationnelles dont rien ne peut s’échapper. Pour un objet de densité solide comme 3I/ATLAS, cette vitesse demeure proportionnelle à son diamètre.
Dans ses travaux récents, l’astrophysicien a établi que le diamètre de 3I/ATLAS se situe quelque part entre 5 et 46 kilomètres, une estimation basée sur l’absence de recul observable lors de sa perte de masse en direction du Soleil et sur les données de luminosité recueillies par le télescope spatial SPHEREx. Cette fourchette dimensionnelle implique, selon ses calculs, que la vitesse de libération gravitationnelle oscille entre 1,3 et 12 mètres par seconde.
Quand Usain Bolt surpasse la gravité d’un astéroïde
La comparaison formulée par Avi Loeb ne manque pas de vitesse : le record du monde du 100 mètres, établi par Usain Bolt en 2009 avec un temps de 9,58 secondes*, correspond à une vitesse de 10,44 mètres par seconde. Comme l’explique le chercheur, « cette vitesse record équivaut à la vitesse de libération d’un astéroïde de 40 kilomètres de diamètre ». Autrement dit, un sprinter atteignant cette vitesse olympique décollerait littéralement de la surface d’objets spatiaux de taille inférieure ou égale à 3I/ATLAS, dont les dimensions avoisinent celles de l’État américain du Rhode Island.
L’astronome tempère toutefois cet exercice théorique en soulignant une limite physiologique évidente. Pour atteindre une telle vélocité, les poumons d’un athlète nécessiteraient un apport en oxygène à pression atmosphérique, condition uniquement réalisable à l’intérieur d’un vaisseau spatial. Sans gravité artificielle générée par la force centripète d’un habitacle en rotation rapide, un corps se déplaçant à cette allure rebondirait inévitablement contre les parois de l’appareil.
Une rotation lente qui préserve l’intégrité structurelle
Les observations astronomiques indiquent que 3I/ATLAS effectue une rotation complète en 16,16 heures, ce qui correspond à une vitesse de rotation de surface comprise entre 0,25 et 2,5 mètres par seconde. Dans ces conditions, précise Avi Loeb, « la force gravitationnelle de cohésion dépasse d’un ordre de grandeur la force centrifuge », ce qui signifie que la rotation actuelle demeure bien inférieure au seuil critique de dislocation d’un noyau cométaire maintenu par sa propre gravité .
Pour un objet plus dense, la gravité s’avérerait naturellement plus forte. Si 3I/ATLAS possédait une densité comparable à celle du fer, sa vitesse de rotation ne représenterait que 4% de sa vitesse de libération, un ratio similaire à celui observé pour notre propre planète .
Un impact gravitationnel infinitésimal sur Mars
Le passage de 3I/ATLAS à proximité de Mars, le 3 octobre dernier, a montré la faiblesse de son influence gravitationnelle. Bien que l’objet soit passé à une distance minimale de 29 millions de kilomètres de la planète rouge à une vitesse fulgurante de 67 kilomètres par seconde, l’impulsion gravitationnelle transmise à Mars s’est révélée microscopique.
Ce contraste entre la masse imposante de l’objet et son influence gravitationnelle dérisoire démontre une réalité fondamentale de la mécanique céleste. La gravité dépend certes de la masse, mais aussi de la distance et de la densité. Un astéroïde de quelques dizaines de kilomètres, même doté de milliards de tonnes de matière, ne peut exercer qu’une attraction négligeable sur des corps distants de plusieurs millions de kilomètres.
Un charisme scientifique qui compense la faiblesse gravitationnelle
L’astrophysicien conclut son analyse par une observation teintée d’ironie.
Malgré sa faible gravité, 3I/ATLAS suscite beaucoup d’intérêt public. Il s’agit d’une signature de sa gravité accrocheuse et non de sa masse gravitationnelle.
Le passage de cet objet interstellaire, seulement le troisième détecté traversant notre système solaire après ‘Oumuamua en 2017 et 2I/Borisov en 2019, représente en effet une occasion en or pour la communauté scientifique d’étudier des matériaux provenant d’autres systèmes stellaires.
La fenêtre d’observation, qui se referme progressivement alors que 3I/ATLAS poursuit sa trajectoire à travers notre système solaire. Les données collectées pendant ce transit permettront d’affiner notre compréhension de la composition et de la dynamique des objets interstellaires. La prochaine détection d’un tel voyageur céleste pourrait prendre des années, voire des décennies.
* Le record du 100 m a été établi lors des Championnats du monde à Berlin en 2009, avec une vitesse moyenne de 37,58 km/h et une vitesse maximale atteinte à 44,72 km/h entre 60 et 80 m
Source : Avi Loeb